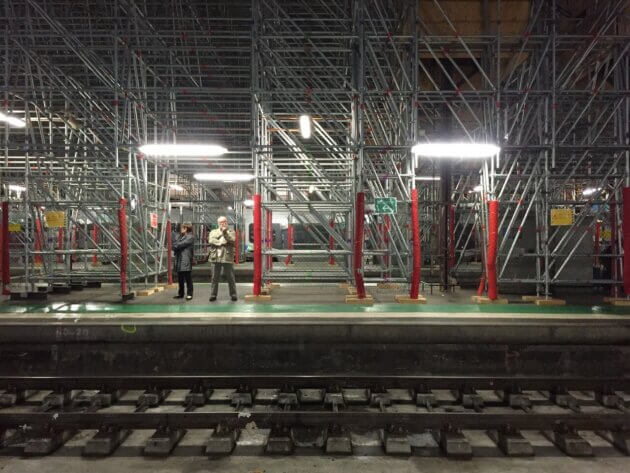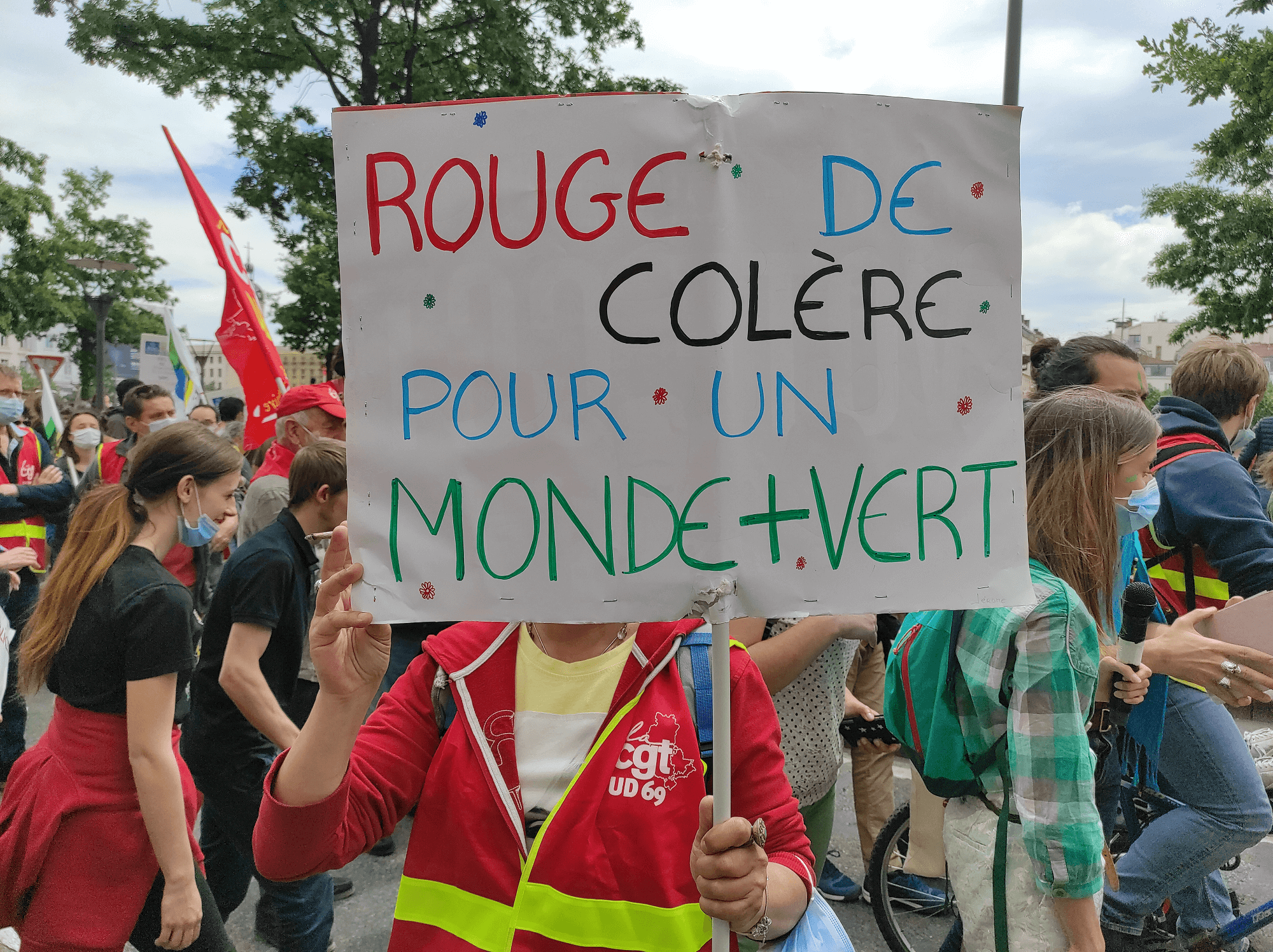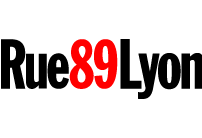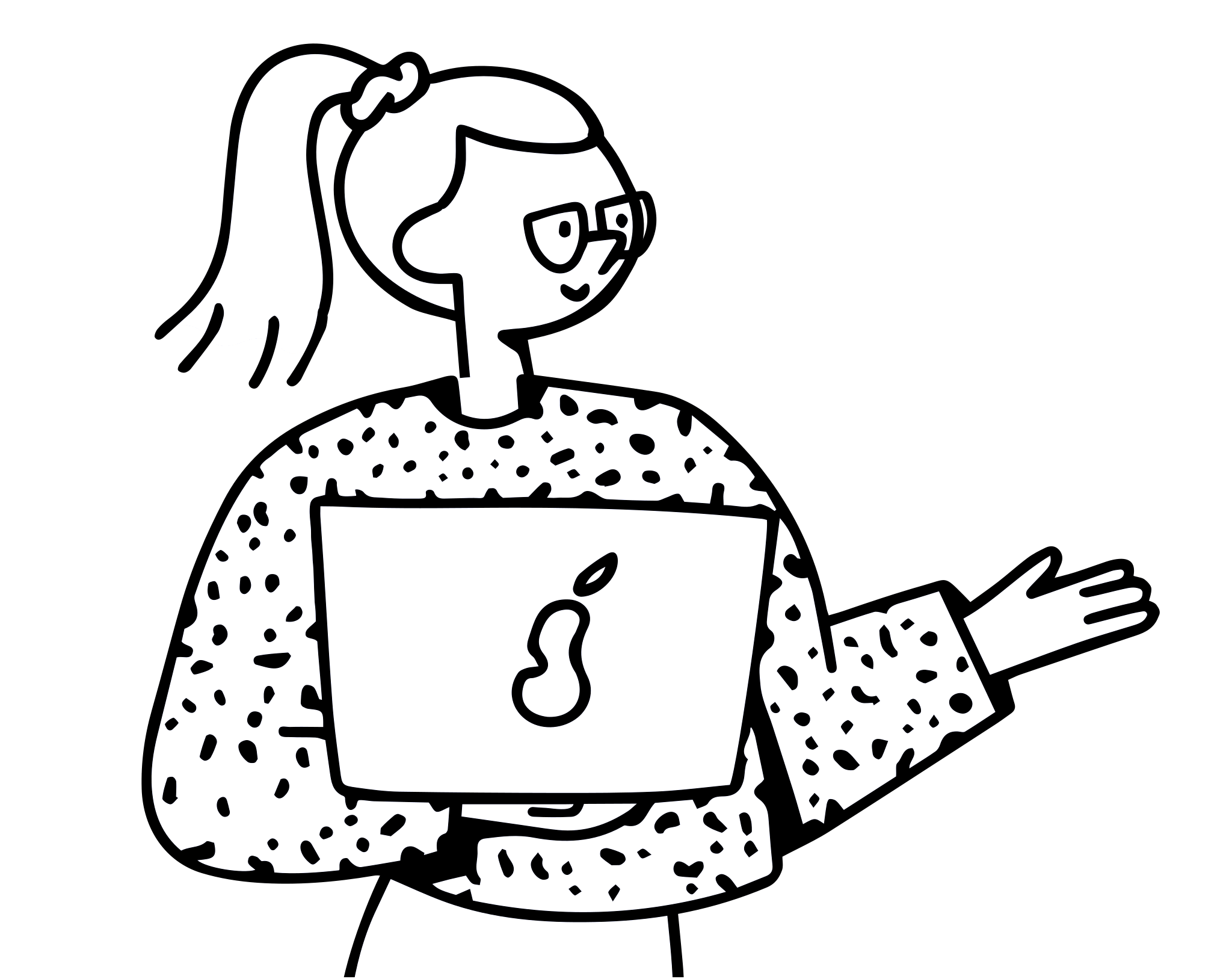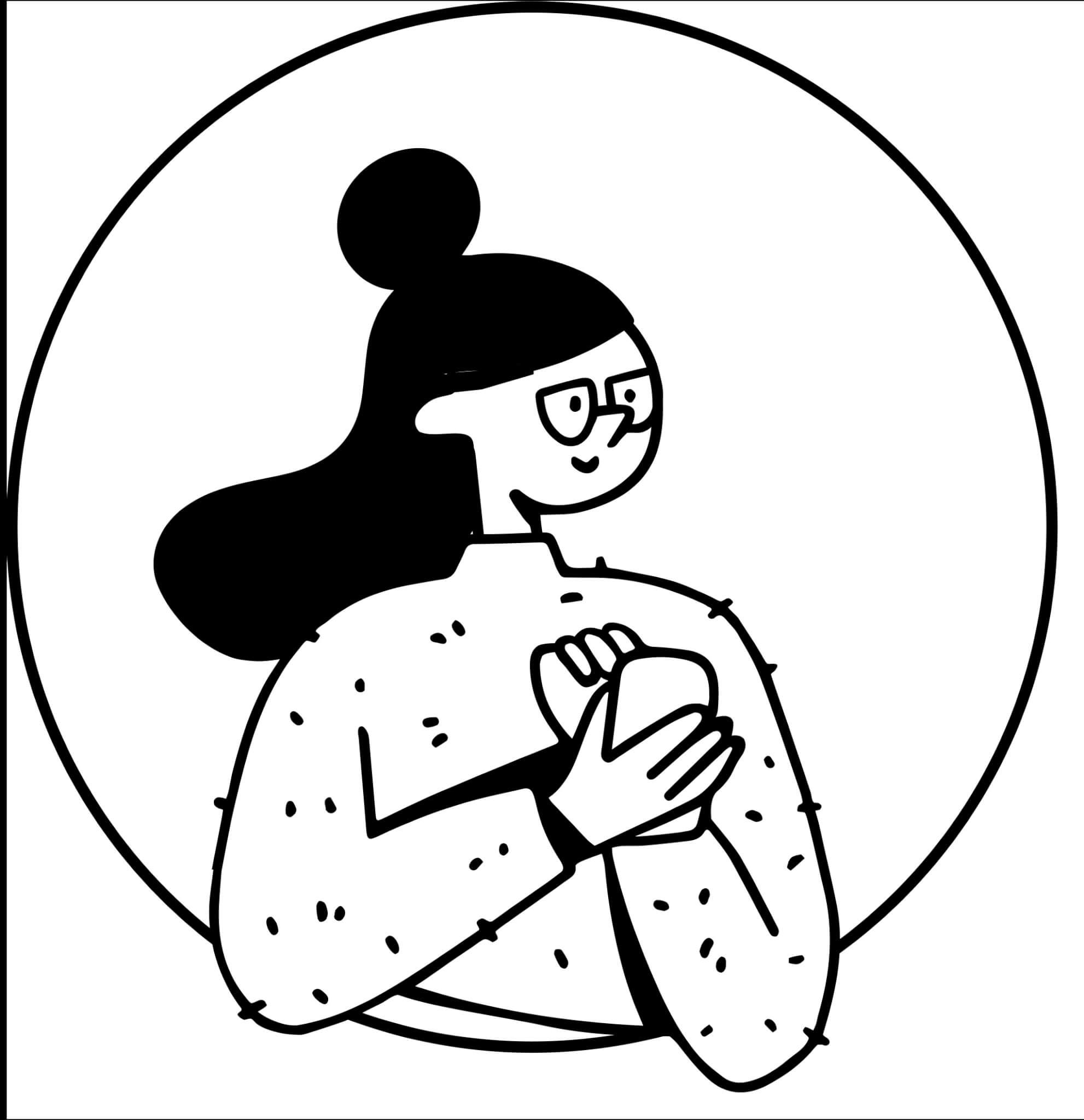Mohamed Tria, président du club de football de l’AS Duchère devenu Sporting club de Lyon, passe la main. Président du club depuis 2008, il n’en était déjà plus l’actionnaire majoritaire depuis l’an dernier. Sa présidence a marqué le développement du club et son identité sociale liée au quartier de La Duchère (Lyon 9e).
Vendredi 7 mai, Mohamed Tria a annoncé quitter la présidence du Sporting Club de Lyon. Une page se tourne pour le club de foot qui s’appelait l’AS Duchère jusqu’à l’été dernier. L’entrepreneur qui a grandi dans le quartier, dirigeait le club depuis 2008.
Quand Mohamed Tria prend les rênes du club, il vient alors d’accéder en CFA (actuel National 2). Il laisse aujourd’hui le club en National, l’échelon supérieur et premier du foot professionnel, où il évolue depuis 2016.
« J’ai pris une start-up avec une devanture CFA2 et rien derrière. La vie d’un club, c’est sa jeunesse surtout. On a lancé un programme de formation d’éducateurs diplômés, une dizaine par an. »
déclarait-il au journal l’Équipe en 2018
Avec l’AS Duchère Mohamed Tria veut « établir des ponts »
Au-delà de la réussite sportive de l’équipe première, la présidence de Mohamed Tria restera marquée par la dimension sociale du club. Cette ambition, il l’a décrite et racontée depuis son arrivée à la tête du club, lui le fils d’un père cantonnier devenu gardien d’immeuble dans le quartier de La Duchère. Sa réussite sociale et professionnelle installées, Mohamed Tria regrette « l’entre-soi » qui s’est installé dans le quartier d’enfance.
Alors, il structure l’AS Duchère, un club créé par les pieds-noirs et harkis, et qui compte très peu de licenciés à son arrivée. Il en fait le club de La Duchère, à défaut d’être celui du reste de Lyon, un club formateur dans l’ombre de l’inatteignable Olympique lyonnais. Et plaçant l’utilité sociale au-delà de la réussite sportive.
Le club se dote et forme des éducateurs. Un poste clé. Ceux par qui se transmettent les valeurs que le club souhaite inculquer aux jeunes, en plus des compétences techniques ou tactiques sur le terrain. Les éducateurs font des retours réguliers aux parents sur l’évolution de leurs enfants. Des rendez-vous que le club rend obligatoires.
L’AS Duchère développe aussi des partenariats avec différents acteurs institutionnels ou économiques de la ville et de la région. En plus de l’école de football, le club propose des activités et sorties culturelles aux enfants ou des rencontres dans des entreprises. L’objectif est de permettre « d’établir des ponts ».
Le club devient un pilier de La Duchère
L’AS Duchère devient un pilier du quartier. Un créateur de lien social. En mettant sur pied une section sport-études au collège Victor Schoelcher, le club s’immisce également dans la sphère scolaire. Il assiste même à des conseils de classes des écoles du quartier où sont scolarisés les jeunes du clubs. Le comportement scolaire est, en cas de manquement, sanctionné également au club.
Dans ce projet social, le club ambitionne d’encadrer et d’aider à émanciper les jeunes. L’AS Duchère se dote d’une section féminine. Il propose alors des stages et des activités notamment pendant les vacances quand les enfants ne vont plus à l’école.
Des stages souvent à un prix modique pour les familles de ce quartier populaire. Le club fournit petit-déjeuner et déjeuner. L’occasion d’éduquer aussi à l’alimentation et à la santé. Comme lors des stages « Énergie foot ». Après des matinées passées sur le terrain, le reste de la journée des activités culturelles ou citoyennes sont proposées. Comme de l’éducation aux médias par exemple (Rue89Lyon avait d’ailleurs passé une semaine avec les jeunes du club en 2018 avant de revenir les voir en 2019 pour la création de l’hymne de l’AS Duchère).

Le club oriente un tiers de son budget vers des actions sociales. Une politique qui infuse jusqu’à l’équipe professionnelle :
« Si un joueur n’a pas envie d’entrer dans le modèle d’entraide, il n’a pas sa place avec nous. »
Mohamed Tria, à l’Equipe en 2018
L’ambition sportive de Mohamed Tria pour l’autre club de Lyon
Dans la crise sanitaire actuelle, notamment durant les périodes de confinement, le club a apporter un soutien à certaines familles du quartier. Notamment à travers des distributions d’aides alimentaires.
La réussite sportive n’est pas oubliée pour autant. L’objectif de Mohamed Tria est de hisser l’AS Duchère en Ligue 2, la deuxième division du football pro en France. Pour financer son action sociale mais aussi les ambitions sportives ils fait venir des sponsors et acteurs économiques comme Kéolis, Serfim ou récemment 6e Sens. Dès la première saison en National, il caresse un temps l’espoir d’une accession en Ligue 2. Depuis, le club se maintient en National.
La dimension sociale du club n’a jamais fait courir Mohamed Tria derrière le prestige sportif ou économique de l’Olympique Lyonnais.
« Je crois que l’AS Duchère est un club complémentaire de l’Olympique lyonnais, qui repose sur d’autres valeurs. Je n’ai jamais eu en ligne de mire l’OL. C’est une étoile inaccessible. Ce n’est pas un modèle dans l’environnement où je me trouve. »
déclarait-il à Lyon Capitale
La politique pour servir les intérêts du club
Toutefois, être dans l’ombre peut avoir des inconvénients. Comme lorsqu’il lui a fallu batailler pour obtenir l’accès à des terrains de la Plaine des Jeux de Gerland pour les entraînements de l’équipe pro, sur lesquels l’OL lorgnait pour ses équipes de jeunes. Ou quand en 2016 il avait dû ferrailler pour obtenir de Gérard Collomb alors maire de Lyon, une augmentation de la subvention de la Ville de Lyon. Le club venant alors d’accéder en National et dans le monde professionnel.
Sa présidence a coïncidé avec le deuxième et troisième mandat de Gérard Collomb. Il s’est parfois affiché avec l’ancien maire de Lyon. Mais n’a jamais figuré sur les listes de celui qui fût aussi maire du 9e arrondissement de Lyon où se trouve le quartier de la Duchère. Il porte d’ailleurs aujourd’hui un regard critique sur la politique sportive de l’ancien maire. S’il s’est tenu relativement éloigné de la politique, au-delà des intérêts pour son club, il n’en demeurait pas moins une figure emblématique courtisée.

Pour relancer l’ambition de montée en Ligue 2 et ses rêves de Ligue 1, il a fait entrer au capital du club en 2020 le promoteur immobilier 6e Sens. Ce dernier est alors devenu actionnaire majoritaire. Son arrivée se fait notamment par l’entremise de Jean-Christophe Vincent qui lui succède aujourd’hui à la présidence du Sporting Club de Lyon. Ancienne éminence grise du Parti Socialiste à Lyon et dans la région, investi dans le quartier de La Duchère, il était en charge des affaires institutionnelles et publiques pour le groupe de BTP Serfim, alors sponsor principal du club. Avant de partir pour le groupe 6e Sens où il occupe le poste de directeur général délégué à la stratégie et aux relations publiques.
De l’AS Duchère au Sporting Club de Lyon
Cette arrivée est déjà un tournant dans l’histoire du club. L’AS Duchère devient le Sporting Club de Lyon. Exit la mention de la Duchère. Le club ambitionne de devenir l’autre club de la ville et de la métropole. En plus du changement de nom, le club pourrait changer de stade. Il quitterait alors celui de Balmont à la Duchère pour s’installer dans l’ancien stade du LOU rugby à Vénissieux. Inoccupé depuis le départ du club de rugby vers le stade de Gerland.
Mohamed Tria a expliqué sa décision par une certaine « lassitude ». Climat et résultats sportifs sont plutôt négatifs de surcroît. La saison dernière, un courrier anonyme émanant du « joueurs abusés » avait été envoyé à la DNCG, le gendarme financier du sport professionnel. Il évoque des pressions sur certains joueurs des paiements joueurs via des moyens détournés (contrats aidés ou frais kilométriques). Mohamed Tria et le club avaient porté plainte.
La « lassitude » de Mohamed Tria
La saison en cours, sur le plan sportif est sombre. Le club est actuellement dernier du championnat à quelques journées de la fin du championnat. Il ne sait pas encore s’il évoluera toujours en National la saison prochaine.
En plaçant Jean-Christophe Vincent à sa tête, 6e Sens est donc seul maître à bord du Sporting Club de Lyon. Mohamed Tria le juge désormais « entre de bonnes mains ».





![[Podcast] Plaidoyer pour une architecture de la réparation](https://www.rue89lyon.fr/wp-content/uploads/2021/05/gare-saint-jean-bordeaux.jpg)