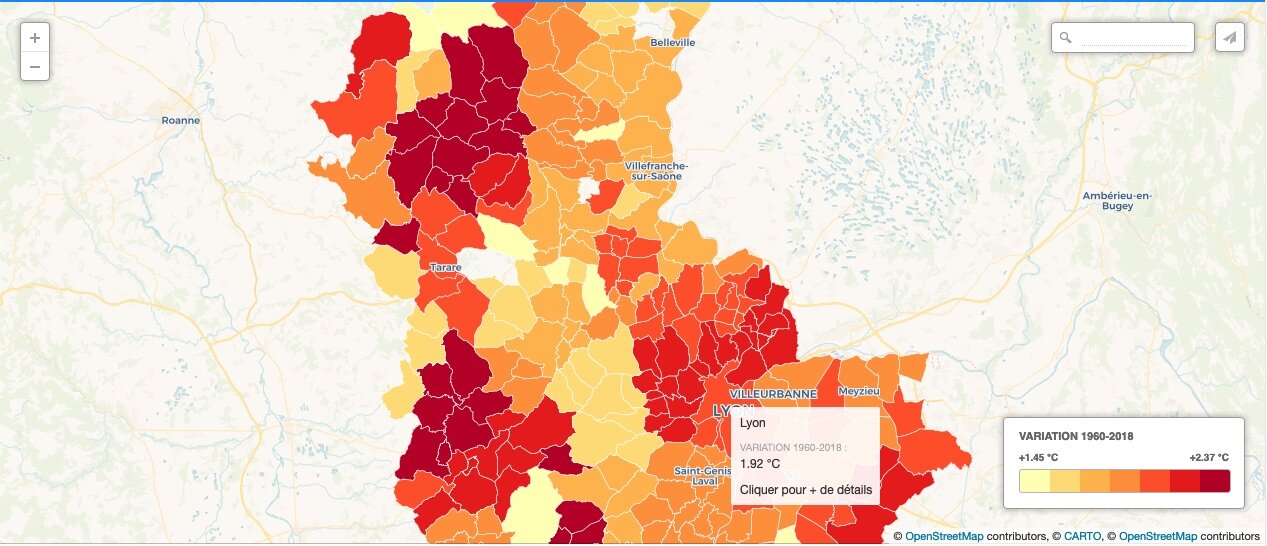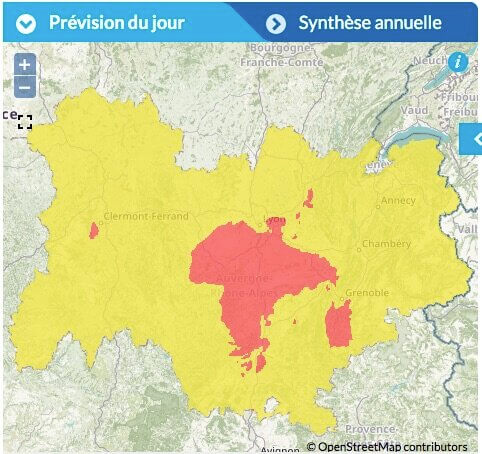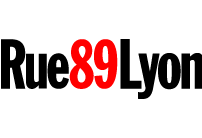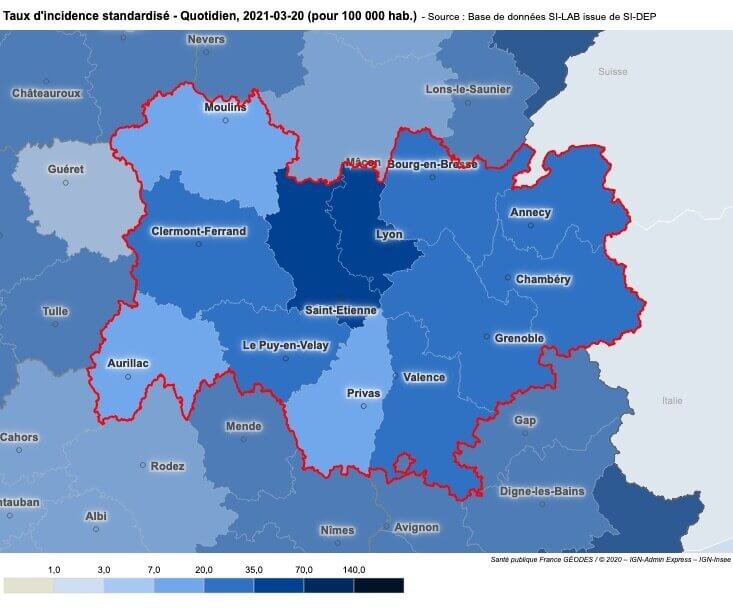Valentin Guigon mène des recherches sur la capacité des gens à identifier ou non des fake news à Lyon. Le chercheur détricote les raisons qui poussent des internautes à croire aux fausses informations. Spoiler : il semblerait que tout le monde puisse tomber dans le panneau. Entretien.
Valentin Guigon est doctorant à l’Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod (ISCMJ) et au Groupement d’analyse et de théorie économique (GATE) de Lyon. Sous la direction de Jean-Claude Dreher et Marie-Claire Villeval, il mène des recherches sur la capacité des personnes à identifier les fake news.
D’après ses premières conclusions, il semblerait que nous soyons tous et toutes aussi nul·les les un·es que les autres pour arriver à déterminer si une information (d’actualité) est vraie ou fausse. Et ce, quelque soit notre niveau d’études, nos opinions politiques ou notre âge, sexe, etc.
Il semble que cette incapacité à identifier les fake news soit particulièrement marquée lorsque les informations sont ambiguës. Or, accorder du crédit à des fake news débouche sur la construction de fausses croyances qu’il est ensuite difficile de démonter.
Tout ça pourrait expliquer en partie le succès de thèses plus ou moins farfelues sur le covid-19 ou les vaccins qui circulent allègrement sur les réseaux sociaux. Entretien.
Rue89Lyon : Comment définir une croyance ?

Valentin Guigon : Une croyance (en épistémologie), c’est une attitude selon laquelle une proposition sur le monde est plus ou moins vraie. On la vérifie par l’expérience ou par les théories. En recherche, on part du principe qu’on ne peut pas connaître l’état du monde jusqu’au fond du cosmos.
« La connaissance, en soi, c’est une croyance parce qu’on ne peut pas être sûr objectivement à 100% »
Par conséquent, nous ne faisons que des inductions, c’est-à-dire arriver à une théorie générale à partir d’éléments très spécifiques. Mais rien ne dit que demain quelque chose ne viendra pas falsifier nos hypothèses. Donc, la connaissance, en soi, c’est une croyance parce qu’on ne peut pas être sûr objectivement à 100 %.
Depuis quand est-ce qu’on s’intéresse aux fausses croyances ?
Des recherches existent depuis très longtemps chez les libraires et les bibliothécaires. Depuis probablement la Seconde guerre mondiale, voire avant, ils se sont demandés s’il fallait montrer, ou non, les fausses informations. Après la guerre, ils ont fait le choix conscient de continuer à les montrer. Selon eux, choisir de ne pas les montrer était une forme de propagande.
« Les gens ne sont pas très bons pour déceler les fausses et les vraies informations »
Vous menez des recherches sur la capacité des personnes à identifier des fake news, qui sont à l’origine de ces fausses croyances. Que constatez-vous ?
J’ai pris des informations « débunkées » sur le fact check de l’AFP, sur Les Décodeurs du Monde et sur Check News de Libération. J’ai 48 informations vraies et 48 fausses. J’ai environ 150 personnes réparties sur deux études qui sont représentatives de la population et je leur demande d’évaluer si les informations sont vraies ou fausses.
Ce qu’on trouve, c’est que les gens ne sont pas très bons pour déceler les fausses et les vraies informations, même s’ils sont un peu meilleurs pour déceler les vraies. Ils arrivent à déceler environ 60 % des informations justes et 40 % des fausses. Ils ne peuvent pas savoir si elles sont toutes vraies ou fausses, ils émettent un jugement à partir de leurs croyances préalables. En moyenne, les gens sont aussi doués que le hasard. Ils pourraient lancer une pièce, ce serait aussi efficace pour savoir si une information est vraie ou fausse.
Y a-t-il un profil type de personnes qui auraient plus de mal à déceler les fausses informations que les autres ?
Non. Ni l’éducation, ni l’âge, ni le sexe… C’est un profil assez commun. On a du mal à évaluer des informations parce qu’elles sont variées, parce qu’on a une expertise dans un domaine mais pas dans un autre…
« Ce qui explique que les gens se trompent (…) c’est l’ambiguïté »
Les gens qui tombent dans le panneau ne sont donc pas plus stupides que la moyenne ?
Non, pour moi c’est clair que non. Ils fonctionnent comme tout le monde. Je pense qu’ils se font avoir par leurs croyances, mais on est tous susceptibles de tomber dans une secte. C’est des gens comme tout le monde. On a tendance à ne pas vouloir le voir. Ce qui explique que les gens se trompent quand ils doivent déterminer si une information est vraie ou fausse, c’est l’ambiguïté.
Comment pouvez-vous déterminer si une information est ambiguë ?
Ça peut être l’ambiguïté sur la source de l’information. Par exemple, pour dire si les informations sont vraies ou fausses, il y a deux critères.
Premièrement : savoir à quel point il y a une volonté de tromper le lecteur. La satyre, par exemple, déforme les informations pour faire rire mais personne n’est dupe alors que la publicité, c’est plus dur à déceler. Il y a une volonté de tromper par le marketing.
Deuxièmement, il faut savoir à quel point l’information correspond à la réalité objective du monde. Forcément, les informations qui correspondent le moins sont celles qui sont le mieux identifiées comme fake news.
Lors d’une expérience, nous avons demandé à 11 personnes si elles jugeaient une information particulièrement ambiguës, ou non. Nous avons pu constater que des informations comme « Il existe des primes de retour pour les migrants » ou « Le terme de « féminicide » a une utilité sur le plan juridique mais peut brouiller les pistes » sont particulièrement ambiguës. Des informations comme « Le système de vote le plus fréquent en Europe est le « vote préférentiel », consistant à classer des candidats par ordre de préférence » ou « Au Danemark, 23% des aliments vendus dans les supermarchés sont bio, le taux le plus élevé du monde selon le gouvernement danois » sont jugées beaucoup moins ambiguës.
Fake news : « Comme le monde est incertain (…) on va avoir d’autant plus besoin de se positionner »
Des scientifiques et des médias démontent pourtant régulièrement des fake news mais celles-ci continuent à circuler et les gens à y croire. Comment est-ce que cela s’explique ?
On peut d’abord prendre comme angle d’attaque pour comprendre cela la théorie de la dissonance cognitive (Léon Festinger, 1957), qui date des années 50. Elle suit le raisonnement suivant : Pierre aime le foot et sa femme, Marie, mais Marie, elle, n’aime pas le foot. Pierre doit résoudre ce dilemme parce qu’il y a une espèce de dissonance cognitive donc il va modifier ses attitudes et ses opinions, soit en déclarant qu’il n’aime plus Marie, soit qu’il n’aime plus le foot. Ça peut expliquer le fait que des gens cherchent à résoudre ce dilemme en éliminant une partie des sources, pour ne garder que les sources qui confortent leur opinion.
Je ne suis pas trop partisan de cette théorie. Je pense qu’il y a des manières plus simples de l’envisager. Globalement, le monde est assez incertain. Dans ma recherche, si on demande aux gens de dire si une information est vraie ou fausse, ils doivent dire à quel point ils sont sûrs de leur réponse. Le premier point, c’est qu’on trouve que les gens n’évaluent pas très bien. Qu’ils disent être sûrs de leur réponse à 10 %, 30 % ou 90 %, c’est pareil. Ils ont du mal à estimer et à prédire les événements.
Comme le monde est incertain, d’autant plus en ce moment avec le Covid, on a du mal à estimer la probabilité que les événements se déroulent. Mais, comme il est incertain, on va avoir d’autant plus besoin de se positionner, donc d’extrémiser notre confiance en notre jugement. Là où on devrait se dire qu’on n’est peut-être pas sûr de son jugement, les gens vont dire qu’ils sont très sûrs de leur jugement parce qu’ils ont peut-être besoin de choisir une position.
L’intolérance à l’incertitude est également importante pour expliquer le besoin d’arriver à une conclusion sur un élément, ce qui pousse à négliger le caractère justement incertain des infos qu’on a. Il y a aussi ce qu’on appelle le besoin de clôture : le besoin de clôturer un évènement, d’arriver à une conclusion. Face à une situation incertaine, la recherche d’une conclusion amène à prendre une décision sur un objet qui est incertain, donc pour lequel la conclusion n’est pas assurée.
Quand on est face à une information, on s’attend à un gain de savoir sur le monde de sa part. Une information a donc une valeur « épistémique », soit une valeur informative. La valeur d’une information est liée à sa capacité à réduire l’incertitude sur le monde.
Les individus décident d’aller vers une information ou de l’éviter selon l’incertitude sur le monde qu’ils souhaitent réduire ou conserver. Exemple : j’aime Nike mais Nike emploie des Ouïghours. Je peux désirer maintenir l’incertitude sur Nike et les Ouïghours pour pouvoir continuer de consommer du Nike.
« Ceux que l’on va voir sur les réseaux, ce sont les extrêmes »
Les réseaux sociaux peuvent-ils avoir un impact ?
Il y a cet effet de réseau que Twitter représente très bien. On fréquente les gens qui sont autour de nous et on attribue plus de poids, plus de valeur à leur discours qu’à ceux qui sont loin de nous. Si on représentait la population sur une courbe de Gauss pour voir où ils se situent sur un spectre politique gauche-droite, on aurait une majorité de gens au centre, qui vont s’identifier de manière moins extrême à des mouvements politiques.
Peut-être que ceux qu’on va voir sur les réseaux sociaux sont aux extrêmes avec des croyances politiques fortes et du coup vont un peu motiver leurs croyances. Ils sont tellement anti-gouvernement, par exemple, que ça les pousse à négliger beaucoup de sources et à s’enfermer dans leur cercle.
A ceci est aussi mêlé l’effet de biais de confirmation. Les dynamiques de réseaux, au niveau social, sont complexes et impliquent généralement nombre de personnes avec lesquelles on est en lien, diversité du réseau, redondance de l’information dans le réseau, force du lien avec d’autres individus du réseau, etc. Toutes ces propriétés font les bulles de réseau où on peut se retrouver piégé dans des informations similaires. On ne verra plus d’opinions ou d’éléments contraires à nos croyances.
Donc si c’est le gouvernement qui donne une information, ils vont systématiquement en prendre le contre-pied parce que c’est le gouvernement qui le dit ?
Si c’est contraire à leurs croyances, oui. On peut être piégés par nos croyances. Il y a plein de gens qui n’ont pas de croyances ou qui n’ont pas de croyances extrêmes, mais ceux dont les croyances sont extrêmes, il faut qu’ils éliminent une partie des sources pour réconcilier ce qu’ils voient de l’environnement avec leurs croyances.
Le gouvernement est une source d’informations. Comme on assigne une crédibilité à une source d’information, si on n’a plus confiance dans le gouvernement, alors on va le décrédibiliser comme source, et décrédibiliser tous les autres éléments qui font partie de son réseau (ex : médecins, OMS, institutions publiques, ONG, etc.).
On entend dire qu’il y a une crise de confiance dans le gouvernement. Si les gens n’ont plus confiance dans le gouvernement, ils n’auront plus confiance dans d’autres organismes qu’ils rattachent au gouvernement. Une des thématiques qui revient souvent, c’est que les gens qui font de la recherche sont vendus à l’État… Leurs croyances vont faire que s’ils n’ont pas confiance dans le gouvernement, ils ne vont pas avoir confiance dans ce que va dire Emmanuel Macron, ni dans ce que va dire le Conseil scientifique sur le Covid-19, lui-même nommé par le gouvernement.
Sur Twitter, beaucoup d’internautes se sont lancé·es dans des explications virologiques alors qu’ils et elles n’ont aucune formation dans ce domaine. Comment expliquer que certaines personnes leur accordent plus de crédit qu’à des scientifiques ?
Premièrement : parce qu’ils ont une place importante dans leur réseau social. Ils vont donc attribuer à ces sources des attributs positifs (et donc de la crédibilité). Mais, en dehors de ça, à un niveau individuel, c’est quand même très coûteux de se demander pour chaque information si on peut lui faire confiance, si la source est fiable… La solution serait de se dire qu’on ne sait pas parce qu’on n’a pas les éléments suffisants. Mais si on tombe sur une information qui nous dit, par exemple, que le covid n’existe pas, et qu’on avait déjà vu des informations qui disaient cela, le tout va juste être une preuve supplémentaire pour dire que le covid n’existe pas. Ça ne va pas être pondéré par la crédibilité de la source, mais par une personne de plus qui dit la même chose.
C’est une forme de biais de confirmation. Ce biais se met en place parce que l’éviter est très coûteux. On n’a pas le temps d’adopter une démarche expérimentale, on voit l’information comme une preuve supplémentaire de ce qu’on pensait déjà, cette preuve est d’autant plus forte que la source nous semble crédible. C’est une approche probabiliste : la probabilité que l’info soit vraie augmente avec le nombre de sources qui sont d’accord avec. C’est donc une approche sensée. Le problème c’est que la crédibilité des sources et des informations sont mal évaluées.
Traitement médiatique : « On invite des experts, mais ne sait pas sur la base de quels critères ils le sont. »
Est-ce que le traitement médiatique de cette crise, qui a consisté en un défilé de nombreux spécialistes et des informations en continu, a pu avoir une incidence également ?
Il y a tellement d’informations et ça circule tellement vite qu’on a moins le temps de se poser sur chaque information qu’on voit. Quand on est dans une situation d’incertitude, comment on décide ? Chacun va avoir des heuristiques (des méthodes pour raisonner de manière plus rapide, des automatismes) et des biais de raisonnement. Ils sont optimaux quand il faut réagir vite, dans la vie de tous les jours, par exemple.
En dehors de ces situations, les heuristiques et les biais de raisonnement vont nous entraîner vers un raisonnement qui est inadapté parce qu’on devrait plutôt se poser et réfléchir. Et on ne le fait pas. On se fait un peu avoir et c’est profondément humain.
Il y a un problème dans le traitement médiatique. On invite des experts mais on ne sait pas sur la base de quels critères ils le sont. Leurs prédictions ne sont pas précises, ce qui leur permet de se rattraper lorsqu’ils se trompent. On ne peut pas quantifier leur expertise. Et comme leurs prédictions sont floues voire intestables, on ne peut pas les tenir responsables de leurs prédictions. Il faudrait des experts auquel on peut assigner un degré de crédibilité quantifiable et vérifiable. Enfin, il faudrait les tenir responsables de leurs prédictions ratées.
Comment se fait-il que le fait que le gouvernement prenne des mesures de plus en plus contraignantes (le pass sanitaire notamment) ne vienne pas remettre en question ces fausses croyances ?
Je pense que ces gens ont déjà résolu le problème. Par exemple, ceux qui pensent que le covid n’existe pas vont décrédibiliser toutes les preuves qui montrent qu’il existe, tout en accordant du crédit à celles qui montrent qu’il n’existe pas.
Exemple avec les vaccins, notamment, il se trouve que ça rapporte, ce qui est vrai, ça c’est objectif. Eux, ils vont se dire que les médecins qui disent que le covid existe, c’est parce qu’ils se font payer pour vacciner les gens, donc ça décrédibilise ce que disent les médecins. Ça renforce leurs croyances. Généralement, face à des informations polarisantes, l’effet que ça peut avoir sur les opinions, c’est de renforcer les opinions de chacun. Ceux qui sont défavorables le seront plus ; ceux qui sont favorables le seront plus aussi.
Le vaccin ? Un dilemme entre liberté et sécurité
Comment analysez-vous les mobilisations anti-pass sanitaire ? On n’y trouve pas que des personnes qui ont de fausses croyances sur le covid…
Sur YouTube, il y a un vulgarisateur en philo qui s’appelle M. Phi (Thibaut Giraud de son vrai nom). Il s’est penché sur la question des manifestations anti-pass sanitaire et il résumait ça à un dilemme entre la liberté et la sécurité, le fait d’abandonner des libertés pour plus de sécurité. Selon lui, les gens font un calcul et s’ils pensent que le gain sécurité sera trop faible donc ça ne vaut pas le coup d’abandonner sa liberté avec le pass sanitaire par exemple. Cette position me semble très rationnelle.
Le vaccin, c’est une question complexe. Les gens sont frileux donc je pense qu’ils en reviennent à cette position où il faut trancher entre liberté et sécurité. Ça me semble parfaitement humain. C’est la question de ce qu’on veut en tant que société. C’est logique qu’il y a ait un dissensus. C’est normal avec des gens qui appartiennent à plein de mouvements différents, avec des sensibilités politiques différentes…
Le problème, c’est quand il y a des fausses informations qui s’en mêlent et que les gens estiment mal le gain de sécurité qu’on pourrait avoir avec le pass sanitaire par exemple.
« Il faut peut-être reconnaître le caractère incertain de certaines informations »
Comment est-ce qu’on peut encourager des personnes à remettre en question les fake news auxquelles elles croient ?
C’est compliqué. Gordon Pennycook et David Rand ont fait beaucoup d’études pour essayer de trouver des mécanismes pour réduire l’apparition des fake news. Sur Facebook, un dispositif signalait les informations considérées comme non-validées par un fact-checker tiers via une petite pastille rouge. Le signalement a permis de diminuer la croyance des personnes en ces informations-là.
Les informations plus ambigües sont plus difficiles à cerner (donc pas de pastille rouge). Les gens qui ont vu des informations avec la pastille rouge qui indique qu’elles sont sûrement fausses vont moins avoir confiance en celles-ci mais ils vont avoir plus confiance en celles qui n’ont pas la pastille. Ils vont se dire qu’elles n’ont pas été identifiées comme fausses, donc c’est qu’elles doivent être vraies et qu’on peut leur faire confiance. Alors que des fois, c’est simplement qu’on n’arrive pas à déterminer si c’est vrai ou faux. Cette mesure-là avait tendance à diminuer la croyance des gens dans les informations dont on sait qu’elles sont fausses, mais à augmenter leur croyance dans celles dont on ne sait pas si elles sont vraies ou fausses.
Quelles solutions donc ? Peut-être reconnaître le caractère incertains de certaines informations. Ils s’agirait finalement d’accepter de ne pas trancher en faveur d’un jugement ou accepter que le jugement soit temporaire jusqu’au moment où on aura suffisamment de preuves pour trancher. Dans le processus d’évaluation des informations, Pennycook et Rand, avec leurs mécanismes testés sur les réseaux sociaux, se forcent à préciser au maximum les conditions dans lesquelles une affirmation est vraie. C’est peut-être déjà un début.