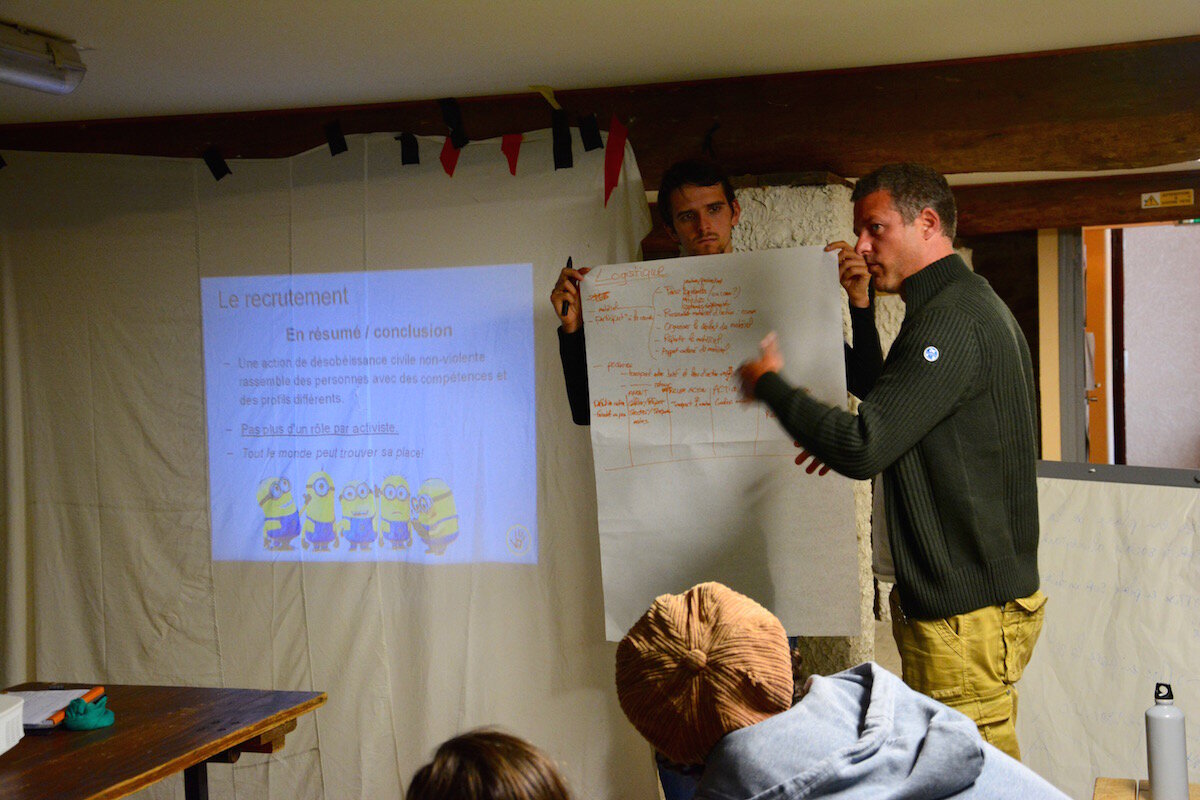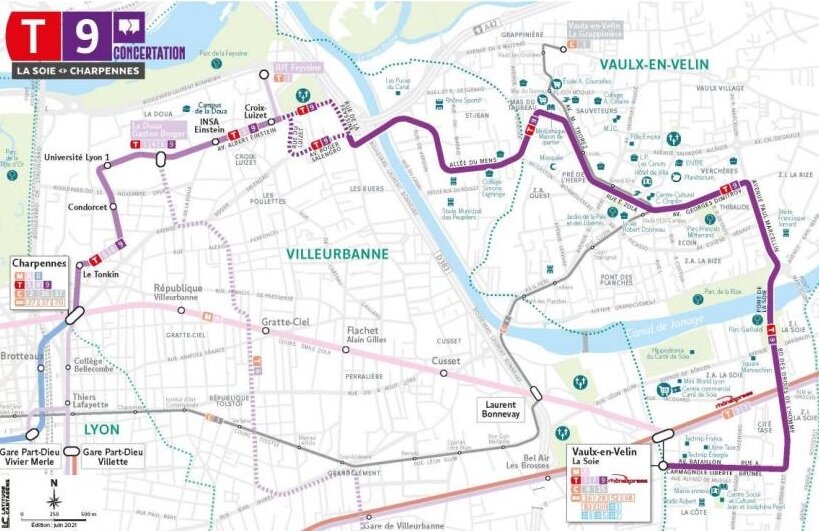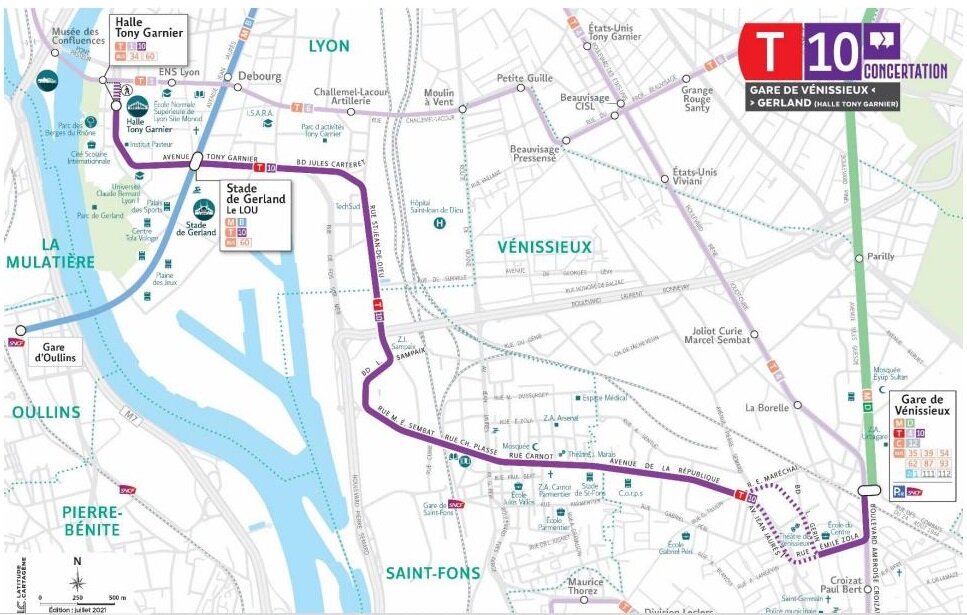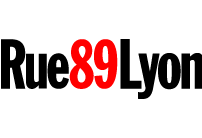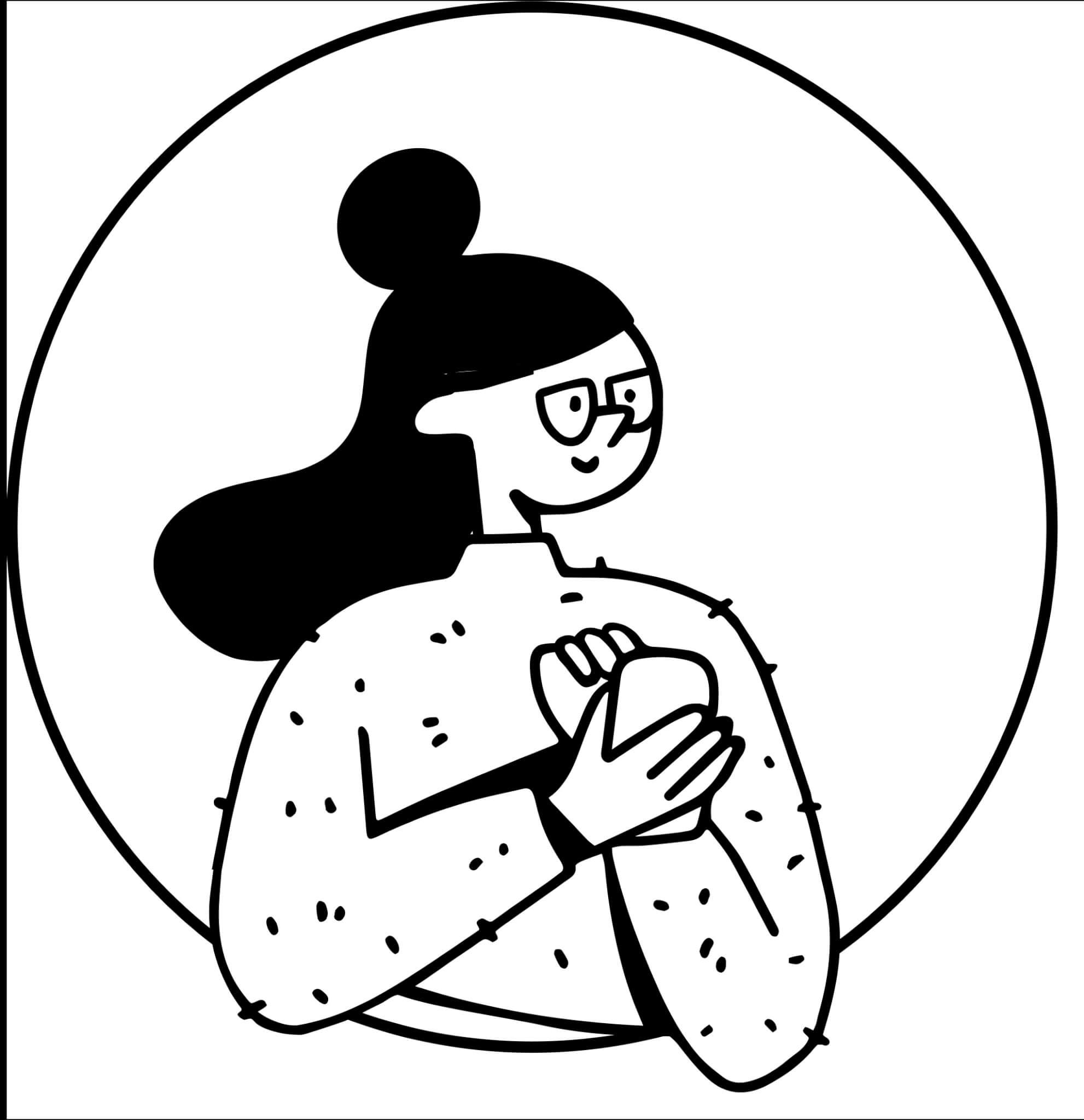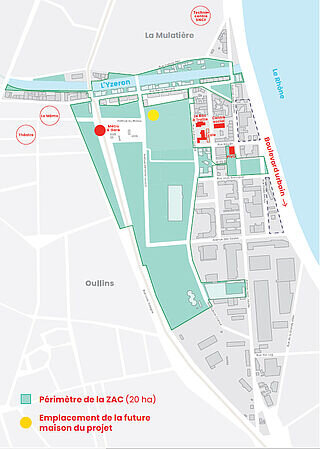D’après l’indicateur annuel de l’association GAELIS pour la rentrée universitaire de septembre 2021, les étudiants et étudiantes de Lyon devront débourser plus d’argent que la moyenne nationale.
Pour les étudiantes et étudiantes, les rentrées se suivent et se ressemblent. Chaque année, nombre d’entre elles et eux devront se débrouiller pendant de longs mois avec un budget plus que serré, dans lequel le loyer et la nourriture peinent à rentrer tous les deux. Pour suivre l’évolution du coût de la vie étudiante, l’association GAELIS publie chaque année depuis 2012 son « indicateur du coût de la rentrée« , qui estime la somme d’argent que doit débourser chaque étudiant·e en septembre, en prenant comme référence un profil-type d’un étudiant de 20 ans, inscrit en licence à l’université, non-boursier et qui vit seul.
Pour la dixième année consécutive, l’indicateur de GAELIS annonce une rentrée de septembre 2021 marquée une fois de plus par la précarité étudiante. Particulièrement à Lyon, où étudier semble en passe de devenir un luxe.

Faire sa rentrée universitaire à Lyon, un luxe ?
En novembre 2019, la précarité étudiante avait brutalement été mise en lumière à Lyon suite à la tentative d’immolation d’un étudiant de l’Université Lumière Lyon 2, Anas Kournif.
Avant de tenter de mettre fin à ses jours devant le CROUS du 7e arrondissement de Lyon, le jeune homme avait laissé sur les réseaux sociaux un message racontant la perte de sa bourse et de son logement étudiant, l’impossibilité d’obtenir une aide exceptionnelle, ses difficultés à subvenir à ses besoins pour pouvoir continuer ses études et l’impasse dans laquelle l’étudiant s’était retrouvé. Sa tentative d’immolation avait été suivie par des mobilisations étudiantes conséquentes dans la rue comme sur les réseaux sociaux sous le slogan « La précarité tue ».
Quelques mois plus tard, la crise sanitaire du Covid est venue exacerber cette précarité étudiante déjà préoccupante. De nombreux étudiants et étudiantes ont présenté des difficultés à subvenir à leurs besoin sur la dernière année universitaire, nécessitant la distribution de pâtes, légumes, papier toilette et autres produits de première nécessité. Ainsi, GAELIS rappelle avoir distribué pas moins de 25 000 paniers-repas en un an. Et elle n’a pas été la seule association à avoir distribué de la nourriture aux étudiants.
Cette rentrée de septembre 2021 se fera dans un contexte sanitaire aussi tendu qu’il y a un an, avec en outre des frais encore plus élevés que les années précédentes d’après la présidente de GAELIS, Coline Pisaneschi :
« Depuis plusieurs années, le coût de la rentrée a fortement augmenté, ce qui n’a fait que creuser la précarité de la population estudiantine, déjà fragile. L’accès à l’enseignement supérieur ne devrait pas être synonyme de précarisation. Or, étudier dans l’une des plus grosses villes étudiantes du pays coûte de plus en plus cher et tend à devenir un luxe. »
Faire ses études à Lyon serait-il en train de devenir un luxe ? D’après les derniers indicateurs de GAELIS, en 2020, le coût de la rentrée universitaire s’élevait à 2470,18 euros à Lyon, contre 2344,70 euros en 2019. Cette année, les étudiants et étudiantes devront débourser en moyenne 2410,13 euros pour faire leurs études à Lyon, une somme au-dessus de la moyenne nationale de 2392 euros, en hausse de 1,32% par rapport à la rentrée 2020.
En cause, une augmentation générale du coût de la vie à Lyon, avec des frais courants plus importants pour la nourriture, la téléphonie et internet. Cette hausse des dépenses qui attendent les étudiants et étudiantes à la rentrée est toutefois limitée par la baisse des frais liés au Covid-19, qui avaient atteint des sommes particulièrement élevées l’année dernière.
Reste le point le plus épineux d’un budget étudiant : le logement, premier pôle de dépense pour beaucoup. D’après une étude de la Fédération des associations générales étudiantes (Fage) basée sur les données de LocService, Lyon se retrouve cette année sur la troisième marche du podium des villes de province les plus chères de France, juste derrière Annecy et Nice. Du côté de l’UNEF, avec une autre méthode de calcul, les résultats restent similaires : Lyon se retrouve également en tête de liste, deuxième ville de province la plus chère de France, derrière Nice.
Une rentrée universitaire marquée par les séquelles de la crise sanitaire
Alors que le Covid en est à sa 4e vague épidémique en France, GAELIS tire la sonnette d’alarme sur les conditions d’études qui s’annoncent tout aussi compliquées cette année. Or, d’après l’enquête FAGE-ISPSOS 2021 publiée en mai dernier, 72 % des jeunes de 18-25 ans ont rencontré des difficultés financières pendant la crise sanitaire. Pour beaucoup, le Covid a mis un terme à leur job étudiant, ne leur permettant plus de subvenir à leurs besoins.

Outre la précarité financière des étudiant.es, GAELIS insiste sur leur santé mentale. D’après cette même enquête, une proportion d’étudiant·es tout aussi importante (76%) affirme avoir rencontré des difficultés psychologiques pendant la crise sanitaire. En décembre 2020, Lyon a été secouée par le suicide d’un étudiant et par la tentative de deux autres. Plus largement, 94% des étudiant.es qui ont répondu à cette enquête ont déclaré avoir décroché de leurs études.
Dans le dossier de presse concernant cette rentrée de septembre 2021, GAELIS se montre plutôt pessimiste et redoute une année universitaire tout aussi compliquée que la précédente :
« Cette rentrée 2021 s’annonce particulière pour les étudiant·e·s. Après 1 an et demi sans avoir eu de cours en présentiel, nous ne sommes toujours pas assuré·e·s de pouvoir reprendre nos études de façon optimale et en toute sécurité. […] Enfin, les conséquences de cette crise vont perdurer dans le temps : les séquelles après plus d’un an d’isolement et de très grande instabilité, financière comme émotionnelle, vont marquer durablement cette génération qui doit avoir un réel soutien et un accompagnement pérenne. »