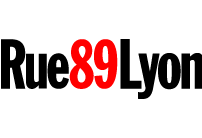En août 2021, la rédaction de Rue89Lyon dressait le portrait de quatre athlètes de participant aux Jeux paralympiques de Tokyo. Trois ans plus tard, ils sont tous en course pour les épreuves de Paris, du 28 août au 8 septembre. À cette occasion, nous rediffusons leurs portraits. Ici, celui d’Angélina Lanza.
Originaire du Togo, Angélina Lanza a découvert l’athlétisme durant son enfance, à Grenoble. Dans l’espoir de canaliser l’énergie de la petite fille, son père décide l’inscrire dans un club d’athlétisme. Aujourd’hui âgée de 28 ans, Angélina Lanza pratique toujours l’athlétisme, à Lyon.
Elle représentera la France pour la deuxième fois, aux Jeux paralympiques de Tokyo. Compétitrice dans l’âme, la jeune femme a un adversaire de taille à affronter lors de ces Jeux paralympiques : elle-même. Et elle est compte bien repousser ses limites.
De la petite fille « un peu hyperactive » à l’athlétisme paralympique à Lyon
Toute petite, elle fait preuve d’une belle énergie qui pousse son père à lui trouver une activité dans laquelle elle puisse se dépenser.
« J’étais un peu hyperactive, à courir de partout, se souvient-elle en rigolant. Quand j’avais une dizaine d’années, mon père m’a inscrite à l’athlétisme pour canaliser mon énergie. »
Courses, lancers, sauts… L’athlétisme séduit immédiatement la petite fille, en particulier le sprint et le saut en longueur. Du haut de ses 10 ans, Angélina Lanza fait déjà preuve d’un bel esprit de compétition. Elle s’entraîne dans un club valide, sans prendre conscience des séquelles laissées par une poliomyélite, contractée durant l’enfance.
« La maladie a touché mes muscles et mes nerfs. J’ai appris à vivre avec ces séquelles sans problème mais je manque de d’amplitude. Il y a des mouvements que je ne suis pas capable de faire, même si j’ai appris à m’adapter. »
A 17 ans, Angélina Lanza concourt au niveau régional. A l’occasion d’une compétition, sa route croise celle de l’ancien entraîneur du pôle France athlétisme handisport de Lyon, Jean-Baptiste Souche, qui lui fait découvrir le monde du handisport.
« Je m’épanouissais chez les valides mais dans le milieu du handisport, on joue à armes égales. Le handisport m’a permis de passer au niveau supérieur. »
Et on peut dire que Jean-Baptiste Souche ne s’est pas trompé. Dès sa première compétition d’athlétisme handisport, à l’occasion des championnats de France de janvier 2011, Angélina Lanza ramène la médaille d’or.
Commence alors une carrière de sportive de haut niveau à Lyon, et les entraînements d’athlétisme passent de trois fois par semaine à sept ou huit fois par semaine.
« J’ai toujours eu l’esprit de compétition, avoue la jeune femme. Une fois que j’ai eu découvert le mouvement handisport, j’ai été plus sérieuse dans ma pratique sportive et j’ai eu pour ambition de faire les Jeux. »
« Mon objectif, c’est de tout donner à chaque fois »
Cinq ans plus tard, Angélina Lanza se présente à ses premiers Jeux paralympiques, à Rio. Cette année-là, l’athlète ne décroche aucune médaille. Pourtant, elle estime s’être surpassée.
« J’ai fini 4e au saut en longueur et 5e au 200 mètres, en battant mes records. Pour les médias, ces places sont souvent synonyme d’échec mais pas pour moi car j’ai été à mon meilleur niveau le jour J. Mon objectif, c’est toujours de tout donner à chaque fois, pour voir jusqu’où je suis capable d’aller. »
En 2018, elle rafle les médailles aux championnats d’Europe d’athlétisme handisport deux Berlin : deux médailles d’or en saut en longueur et en 200 mètres, et une médaille d’argent en relais 4×100 mètres. De quoi démarrer du bon pied pour les Jeux paralympiques de Tokyo.
La performance, c’est bien, mais ça ne suffit pas, affirme la jeune femme. Pour elle, l’aventure humaine que représente la préparation aux Jeux est au moins aussi importante. L’athlétisme doit rester ce qu’il a toujours été pour elle : du plaisir.
« J’adore le sprint, j’aime la vitesse, voir jusqu’à quel point je suis capable d’aller vite. J’aime aussi le saut en longueur et la sensation que j’ai dans les airs, pendant le saut. Tout va à la fois très vite et très lentement. J’ai l’impression de voler, que le temps s’est un peu arrêté et d’un coup je suis dans le sable. J’aime beaucoup cette sensation. »
« C’est grâce à mon père, et mes proches, que j’en suis là aujourd’hui »
Aujourd’hui, Angélina Lanza habite à Lyon et est chargée de communication à la SNCF en parallèle de sa pratique de l’athlétisme à haut niveau. Son statut d’athlète lui permet d’adapter son temps de travail en fonction de ses entraînements.
Pour la jeune femme, il est hors de question d’abandonner la compétition. Elle compte bien repousser ses limites aux Jeux paralympiques de Tokyo.
« Bien sûr, je pense aux Jeux paralympiques de Paris, en 2024, qui devraient être un beau spectacle, mais l’échéance, c’est Tokyo. »
A Grenoble puis à Lyon, comme à Tokyo, Angélina Lanza pourra compter sur le soutien de son père, qui lui a permis de s’épanouir dans l’athlétisme. Quand il l’a inscrite pour la première fois, se doutait-il que cette petite fille de 10 ans s’envolerait un jour pour les Jeux paralympiques ? C’est possible, répond Angélina Lanza dans un rire :
« Au fond de lui, je pense que mon père avait une petite idée. Il m’a toujours soutenue et dit que j’avais du potentiel, sans jamais me mettre la pression. C’est grâce à lui, et mes proches, que j’en suis là aujourd’hui. »