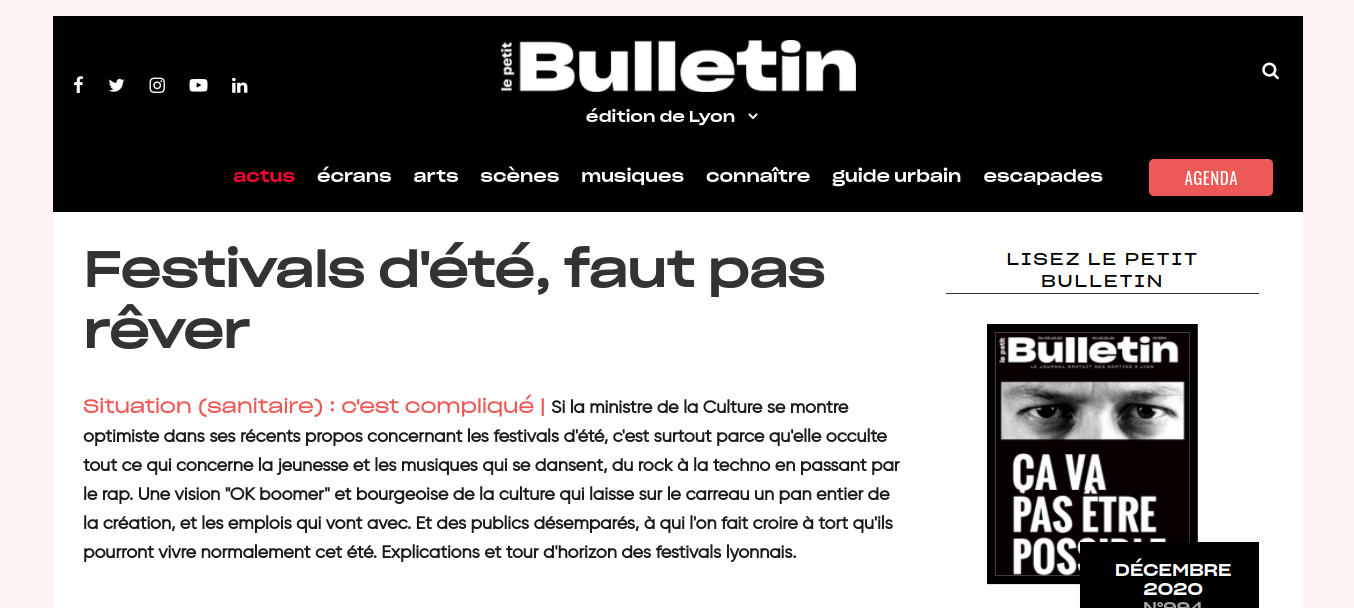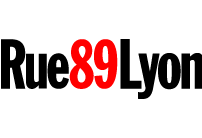Nous ne sommes pas aux mêmes endroits du territoire métropolitain de Lyon. C’est l’existence des points de deal et la lutte contre le trafic de drogue qui seraient à l’origine d’une colère de la part de mafieux. Une façon pour le premier ministre de saluer la police présente dans ces quartiers où ont éclaté ces derniers jours des violences. À la Duchère (à Lyon), à Rillieux-la-Pape et à Bron.
De jeunes dealers qui voudraient imposer leur loi, a-t-on indiqué très vite, jusqu’au sein du gouvernement. Raccourci ?
Douze personnes, dont huit majeurs et quatre mineurs, ont été interpellées et placées en garde à vue, à la suite d’échauffourées avec la police, survenues dans le quartier de la Duchère (dans le 9è arrondissement de Lyon) jeudi 4 mars.
Une personne de 20 ans a été condamnée à huit mois de prison ferme, pour « violences aggravées » et « participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ».
Tout aurait démarré après qu’un jeune garçon a chuté de son scooter, aux abords du lycée La Martinière-Duchère. Des témoins ont indiqué que l’accident avait été provoqué par une course-poursuite avec une voiture banalisée de la police -ce que la préfecture du Rhône a démenti. Le frère de la victime maintient cette thèse. Une enquête a été confiée à l’IGPN (inspection générale de la police nationale ou « police des polices). Une information judiciaire vient d’être ouverte (lire encadré).
Difficile de lier les événements, qui se sont succédé toutefois très rapidement. Vendredi soir puis dans le week-end, d’autres incidents violents sont survenus, à Rillieux-la-Pape notamment. Samedi soir, toujours, à Bron, avec un adolescent hospitalisé dans un état grave, après un malaise. Cinq personnes ont été interpellées, dont quatre mineurs, suite aux incidents ayant eu pour décor le quartier de Parilly.
Gérald Darmanin plie l’enquête sur RTL
Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a tôt fait de mener l’enquête et de qualifier les habitants des quartiers en cause dans les échauffourées ou les violences commises dans l’espace pubnlic. Il comptait dimanche 21 interpellations.
Devant la presse, le ministre a salué le travail de lutte contre le trafic de drogue et ainsi résumé :
« Ces violences urbaines ont notamment comme explication le fait que la police, depuis plusieurs semaines désormais, intervient, harcèle les points de deal […].
Plus il y aura harcèlement de ces points de deal, plus il y a manifestement réaction des dealers, mais à la fin ce sera toujours la police qui va gagner », a assuré le ministre de l’Intérieur au micro de RTL.
Gérald Darmanin, le dimanche 7 mars 2021, au sujet des violences urbaines à Lyon et en banlieue.
Davantage de policiers et de CRS envoyés à Bron et à Rillieux
Une thèse également soutenue par Alexandre Vincendet, maire (Les Républicains) de Rillieux-la-Pape. Le jeune élu compte marcher, entouré de protection, dans les quartiers concernés ce mercredi matin.
Le maire de Bron, Jérémie Bréaud (LR également), avait déjà déjà lui aussi expliqué se battre contre des lieux de deal existants dans sa commune. Et il reliait à cela les menaces de mort portées à son encontre au début de l’année 2021.
Le ministre de l’Intérieur, quant à lui, a dépêché 200 CRS sur l’agglomération de Lyon à la suite des incidents du week-end. Il met une pression forte sur le préfet du Rhône afin que les moyens soient déployés sur les secteurs concernés par les échauffourées entre habitants et police.
Une source policière tend à nuancer ces explications très univoques, indiquant qu’il pourrait tout autant s’agir d’une série de démonstrations de force. Des jeunes qui se donneraient le mot, pour montrer un « savoir-faire » et faire parler de leur quartier. Avec « des armes de guerre dans les mains de gamins ».
« La police souffre d’un déficit de légitimité »
Sebastian Roché, directeur de recherche au CNRS Science-Po Grenoble, a tenté d’apporter nuances et décryptage de ces trois jours de « violences urbaines » dans Lyon et autour de la ville. Il déclare à France 3 :
« Le problème, c’est d’abord la défiance vis-à-vis de la police puisque quand il y a un incident, il y a immédiatement une suspicion. Et là, il y a deux grands facteurs qui expliquent cette suspicion vis-à-vis de la police. C’est d’abord la concentration de la pauvreté et c’est pas un hasard si les événements de Lyon ont démarré à La Duchère, puis ensuite se sont transportés à Rillieux-la-Pape. »
Sebastian Roché, directeur de recherche au CNRS Science-Po Grenoble
Pour lui, « la police souffre d’un déficit de légitimité ». Il convient qu’elle est particulièrement suspecte lorsqu’elle intervient dans les quartiers.
« Il y a un choc qui est causé par la mort ou l’accident d’un enfant. Ça, c’est un choc moral, ça provoque une émotion collective et cette émotion à ce moment-là. Elle se traduit par des comportements de recherche, de correction donc de recherche de la justice et par d’autres destructions et dégradations. Et s’en suivent un certain nombre de prises à partie des des policiers et des gendarmes. »
Sebastian Roché, directeur de recherche au CNRS Science-Po Grenoble
« Le même mécanisme depuis une quarantaine d’années »
En l’état, l’argument d’une réplique d’organisations mafieuses faite à des actions policières visant des points de deal de drogue n’est pas étayé.
Pour le chercheur isérois, c’est « le même mécanisme qu’on a depuis une quarantaine d’années ». Difficile de trouver une recette miracle à un phénomène ancré et au discours polarisé qu’il provoque.
« Si on n’agit pas sur la concentration de la pauvreté, on ne va pas réussir. Mais si on n’agit pas non plus sur les modes d’action de la police, si on n’arrive pas à limiter tout ce qui est violences policières, discrimination policière, on n’y arrivera pas non plus. Il faut marcher sur deux pieds », déclare-t-il.



![[Podcast] Métabolisme urbain : les villes ont-elles un corps ?](https://www.rue89lyon.fr/wp-content/uploads/2021/03/nasa-Manhattan-New-York.jpg)


![[Cadeau] « Un pays qui se tient sage » de David Dufresne : Rue89Lyon vous offre le DVD](https://www.rue89lyon.fr/wp-content/uploads/2020/09/6_TAHA-BENALLAc-Le-Bureau-Jour2fête-2020.jpg)