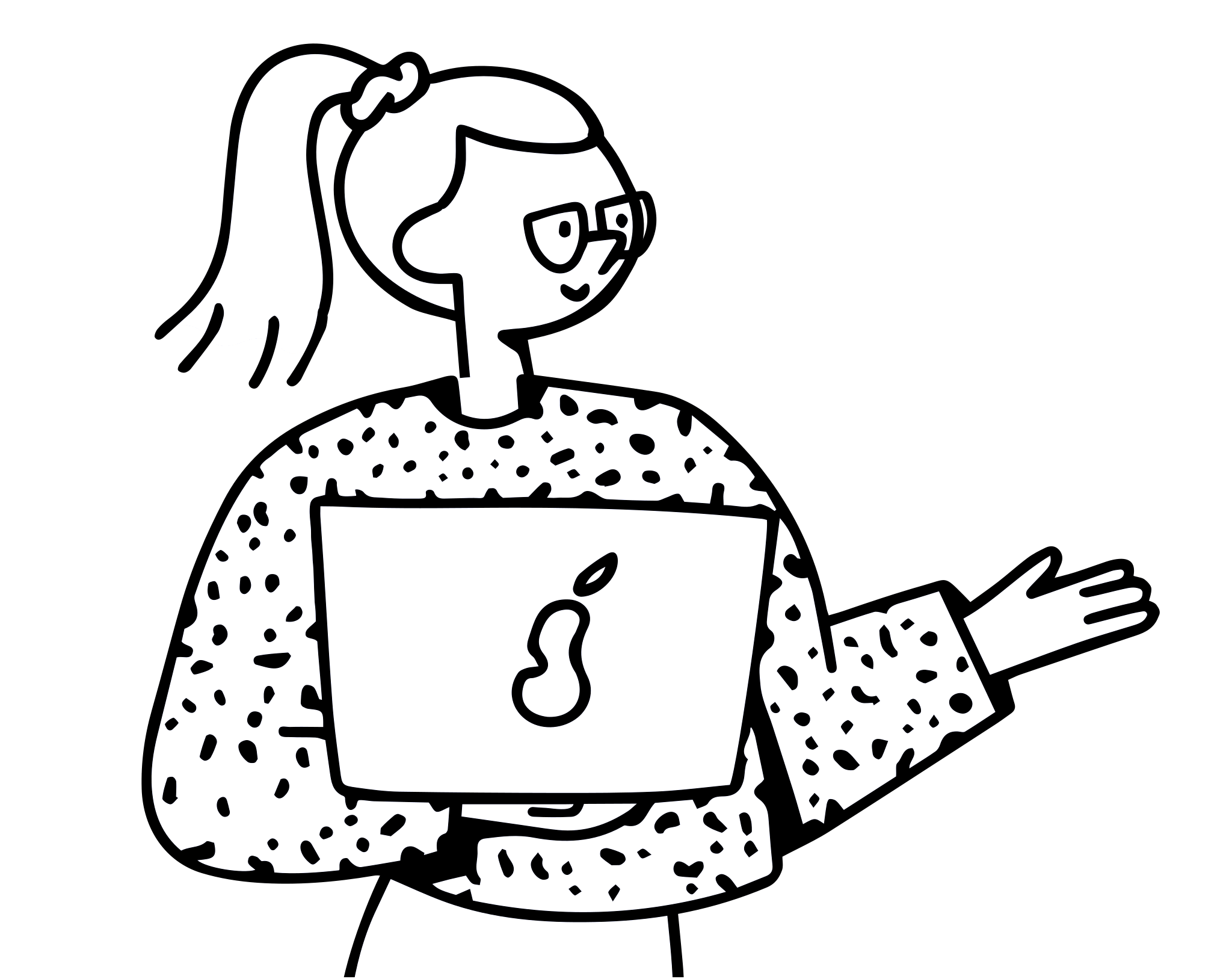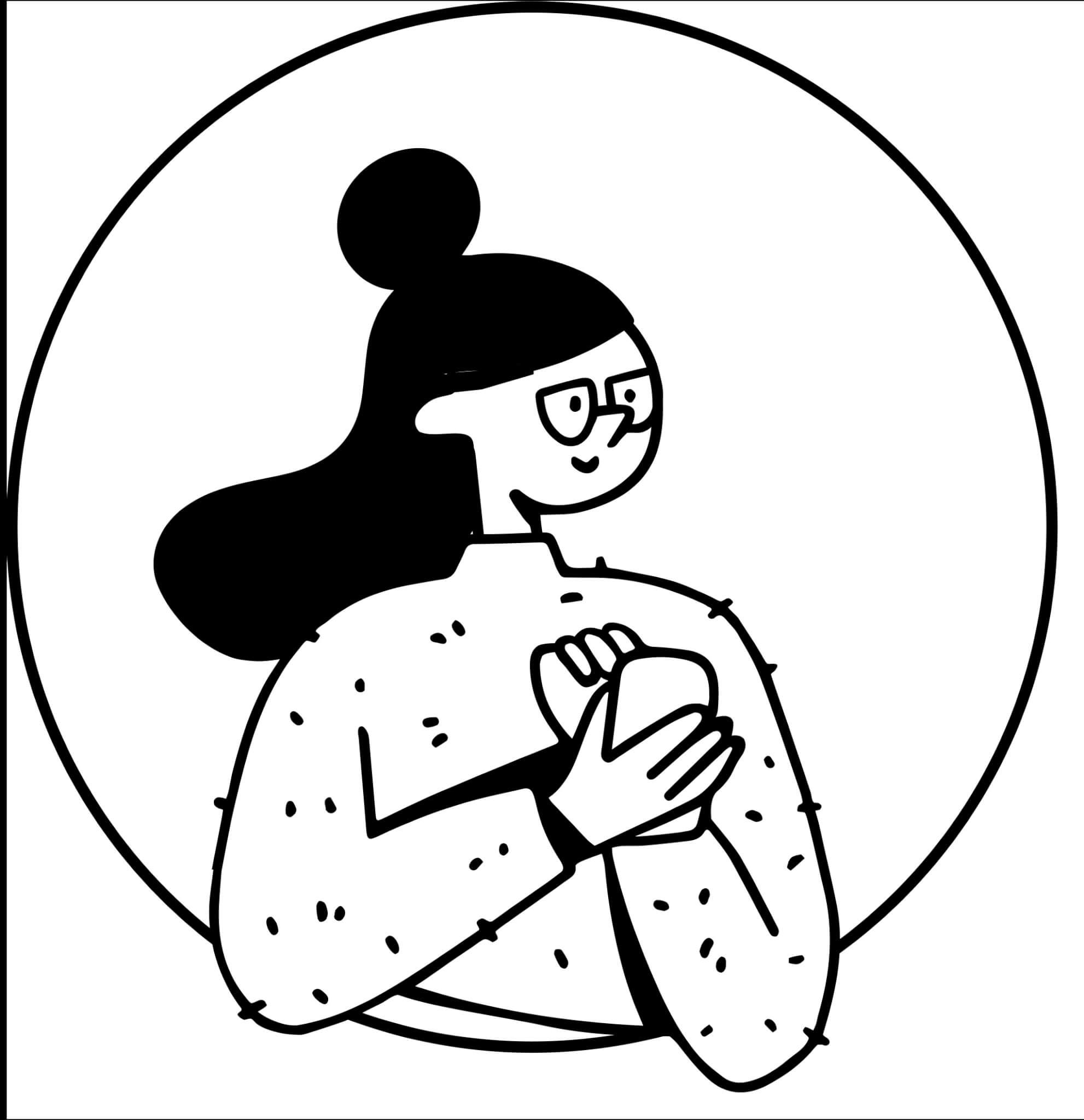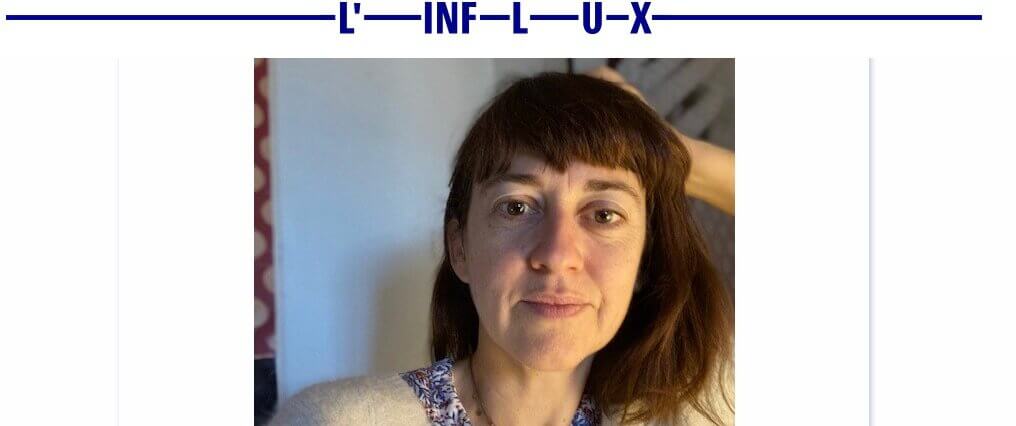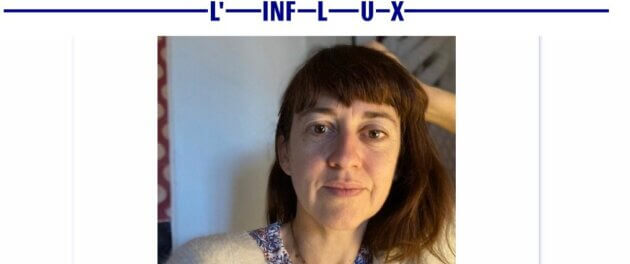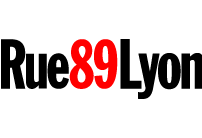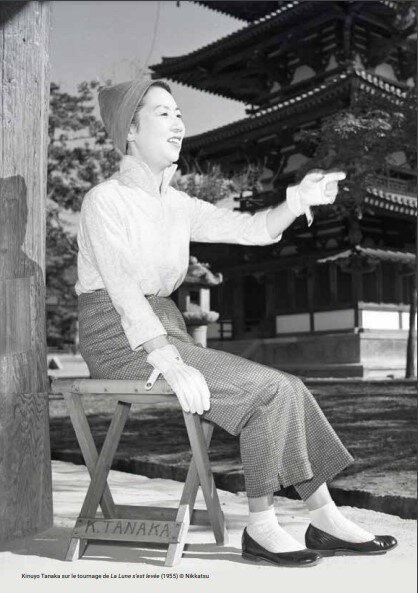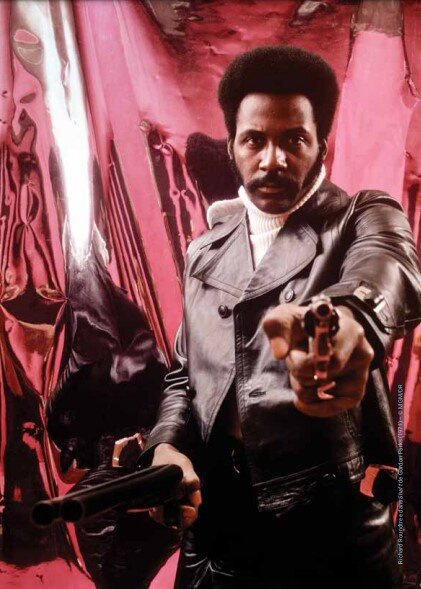La Chine mise sur l’intelligence artificielle, au point de concurrencer la Silicon Valley. Et l’Europe ? Voulons-nous simplement devenir une usine à produire des données dont les géants américains et chinois tireront toute la valeur ? Quelles questions soulèvent l’IA en particulier en matière d’éthique ? Comment appréhender ce défi à l’œuvre ?
Ces questions seront abordées au cours de la session des Mercredis de l’Anthropocène du 13 octobre. Des débats connectés aux enjeux du changement global en perspective.
Cette deuxième séance de la saison 6 se déroulera de 18h30 à 20h à l’Hôtel71 (Lyon 2è) dans le quartier Confluence, sur les bords du Rhône. La présentation d’un pass sanitaire valide et le port du masque sont obligatoires. À écouter également en podcast. Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la Rentrée Anthropocène #2021.
Retrouvez ci-dessous le texte coécrit par François Candelon, directeur général et associé du Boston Consulting Group et directeur monde de l’Institut BCG Henderson avec Stéphane Grumbach, spécialiste des données, directeur de recherche à l’Inria et enseignant à Sciences Po.
Un horizon d’intelligence artificielle généralisée ?
L’Intelligence Artificielle soulève deux questions fondamentales. La première concerne la définition. Qu’est-ce que l’IA ? C’est une question extrêmement complexe. La seconde concerne l’impact de l’IA. Qu’est-ce que l’IA change à l’organisation du monde ? C’est une question beaucoup plus simple, et dont la réponse ne dépend en fait pas de la première.
Le sujet de l’intelligence artificielle est passionnant précisément à cause de ces deux questions, qui touchent de manière fondamentale à notre spécificité en tant qu’humain, l’intelligence, le rapport à la machine, la destinée collective de l’humanité.
La première question est profondément philosophique. Elle s’inscrit dans une longue tradition de réflexion métaphysique, la pensée, la dualité corps et âme, la technique, etc. Elle n’admet pas de réponse définitive.
La possibilité d’une IA générale, c’est-à-dire non limitée à un domaine d’application particulier, capable d’adaptation, comme l’intelligence des humains, soulève par contre des discussions techniques. La deuxième question est celle de l’impact, dans quelle mesure l’IA pourrait ou non changer radicalement le fonctionnement des sociétés humaines.
L’IA change la manière de travailler de nombreux secteurs
Après une histoire chaotique depuis les années 1950, l’IA connaît aujourd’hui de grands succès. A cela deux raisons, la puissance des machines et l’apprentissage, l’idée de ne pas dire à la machine ce qu’il faut faire, mais de la laisser traiter la complexité par elle-même. Force est de constater que l’IA est déjà pervasif. Il change la manière de travailler dans de nombreux secteurs.
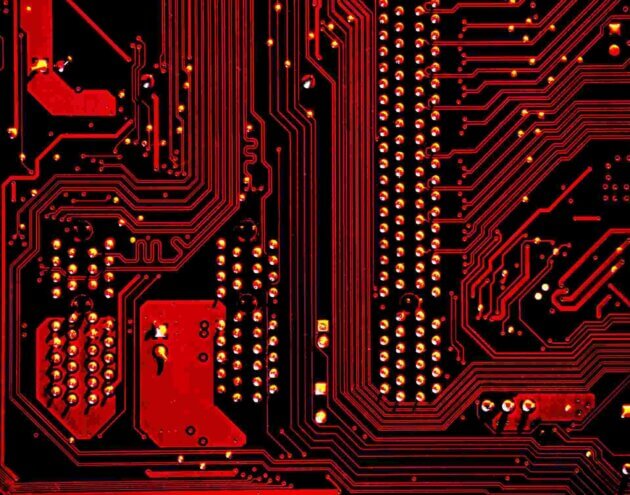
L’IA présente plusieurs caractéristiques qui ouvrent de nouvelles possibilités pour les entreprises. Au-delà des caractéristiques fonctionnelles (vision, lecture, compréhension, …), on peut distinguer trois aspects parmi ses caractéristiques fondamentales qui rendent l’IA si importante :
- Elle permet de formuler des prévisions ou des scénarios avec un niveau de détail extrêmement fin. Par exemple, le constructeur automobile Porsche utilise l’IA pour prendre des décisions de production complexes pour faire correspondre les stocks à la demande locale dans les villes du monde entier, en adaptant la combinaison précise de configurations de voitures, parmi des millions d’options potentielles.L’IA permet d’obtenir des résultats analytiques de façon quasi instantanée même sur d’immenses jeux de données non structurées. Elle permet donc une prise de décision en temps réel. Par exemple la compagnie aérienne néerlandaise, KLM, utilise un outil d’IA pour réorganiser le planning de sa flotte d’avions en temps réel lorsqu’une panne survient sur l’un des appareils. En quelques minutes ils peuvent trouver une solution optimale qui n’est souvent pas à la portée d’un opérateur humain dans un laps de temps aussi court.Enfin, l’IA permet d’étendre une solution à l’ensemble du périmètre d’une société de façon très rapide et pour un coût marginal quasi nul, ce qui permet d’amortir plus facilement les coûts de développement. Par exemple si la SNCF met au point un algorithme de maintenance prédictive sur ses motrices TGV, après avoir validé les gains sur un centre de maintenance pilote, elle peut étendre la solution à l’ensemble de son parc.
L’utilisation de l’IA nécessite une collaboration forte entre homme et machine
La crise sanitaire accélère cette transformation, car elle ajoute de l’incertitude et fragilise les sociétés, ce qui rend donc d’autant plus pertinent ces caractéristiques. L’année dernière, une étude du BCG avec le MIT a révélé que seulement 10 % des entreprises tirent des retours financiers importants de leurs investissements dans l’IA. Pour y arriver, il ne suffit pas simplement d’automatiser ou de réduire certaines corvées, il s’agit de créer une collaboration forte entre l’homme et la machine, avec un apprentissage mutuel et non à sens unique.
Cette année, notre nouvelle étude s’appuie sur cette recherche et suggère un autre avantage de l’IA. La grande majorité des entreprises qui utilisent l’IA constatent des gains culturels tangibles, mesurés par le moral de l’équipe, la collaboration, l’efficacité, etc.
C’est parce qu’une utilisation efficace de l’IA initie un cercle vertueux. Le déploiement de la technologie améliore l’efficacité et la prise de décision, ce qui inspire la confiance entre les équipes, clarifiant les rôles individuels tout en facilitant l’apprentissage et la collaboration. Cela engendre à son tour une plus grande confiance et une volonté accrue d’utiliser l’IA.
L’intelligence artificielle pose aussi des questions très sérieuses à l’humanité
Il est impossible de parler de l’IA, sans aborder son application première, et pour paraphraser Yves Lacoste, insister que le fait que l’IA, ça sert d’abord à faire la guerre. L’IA change le rapport de force dans le conflit. L’IA est essentielle pour la surveillance et la détection d’anomalies.
La sécurité du cyberespace, sur lequel repose la majeure partie des fonctions de nos sociétés doit donc beaucoup à l’IA. Mais au-delà le développement de machines douées de l’initiative de décision, comme les robots tueurs par exemple, change radicalement le rapport entre les humains et les machines. Rien d’étonnant à ce que les leaders de l’investissement dans l’IA soient les deux pays en concurrence pour la domination du monde, les Etats-Unis et la Chine.
« Un horizon d’intelligence artificielle généralisée ? » une conférence en direct le 13 octobre de 18h30 à 20h puis disponible en podcast.
Avec :
– François Candelon, directeur général et associé du Boston Consulting Group, et directeur monde de l’Institut BCG Henderson, groupe de réflexion dédié à l’exploration et au développement de nouvelles idées au croisement du monde des affaires, de la technologie et de la science.
– Stéphane Grumbach, spécialiste des données, est directeur de recherche à l’Inria et enseignant à Sciences Po. Son activité de recherche se concentre sur la question de l’impact de la généralisation de la collecte de données et leur traitement algorithmique sur la société.
Animation : Jérémy Cheval


![[PODCAST] Un horizon d’intelligence artificielle généralisée ?](https://www.rue89lyon.fr/wp-content/uploads/2021/10/michael-dziedzic-aQYgUYwnCsM-unsplash-1.jpg)