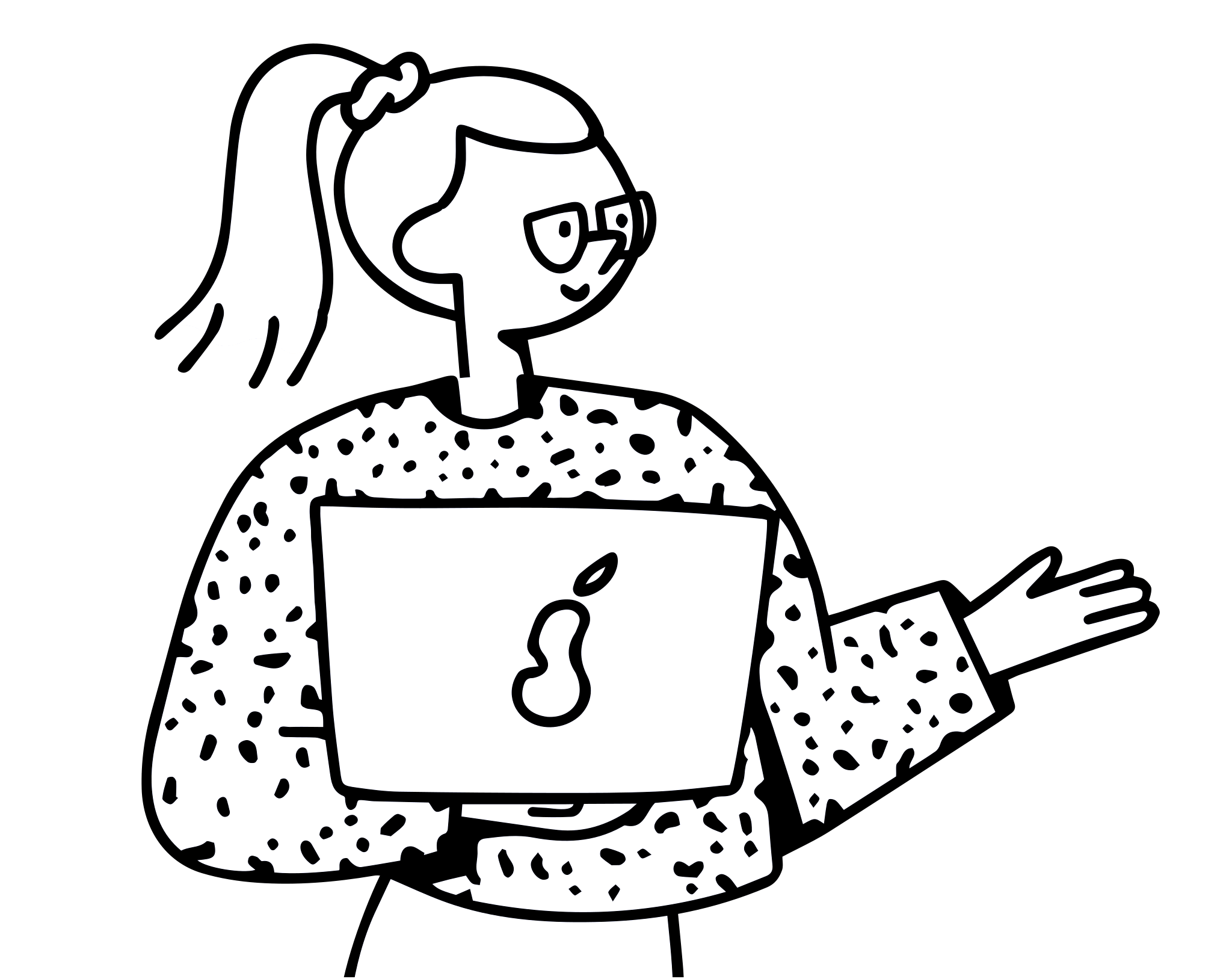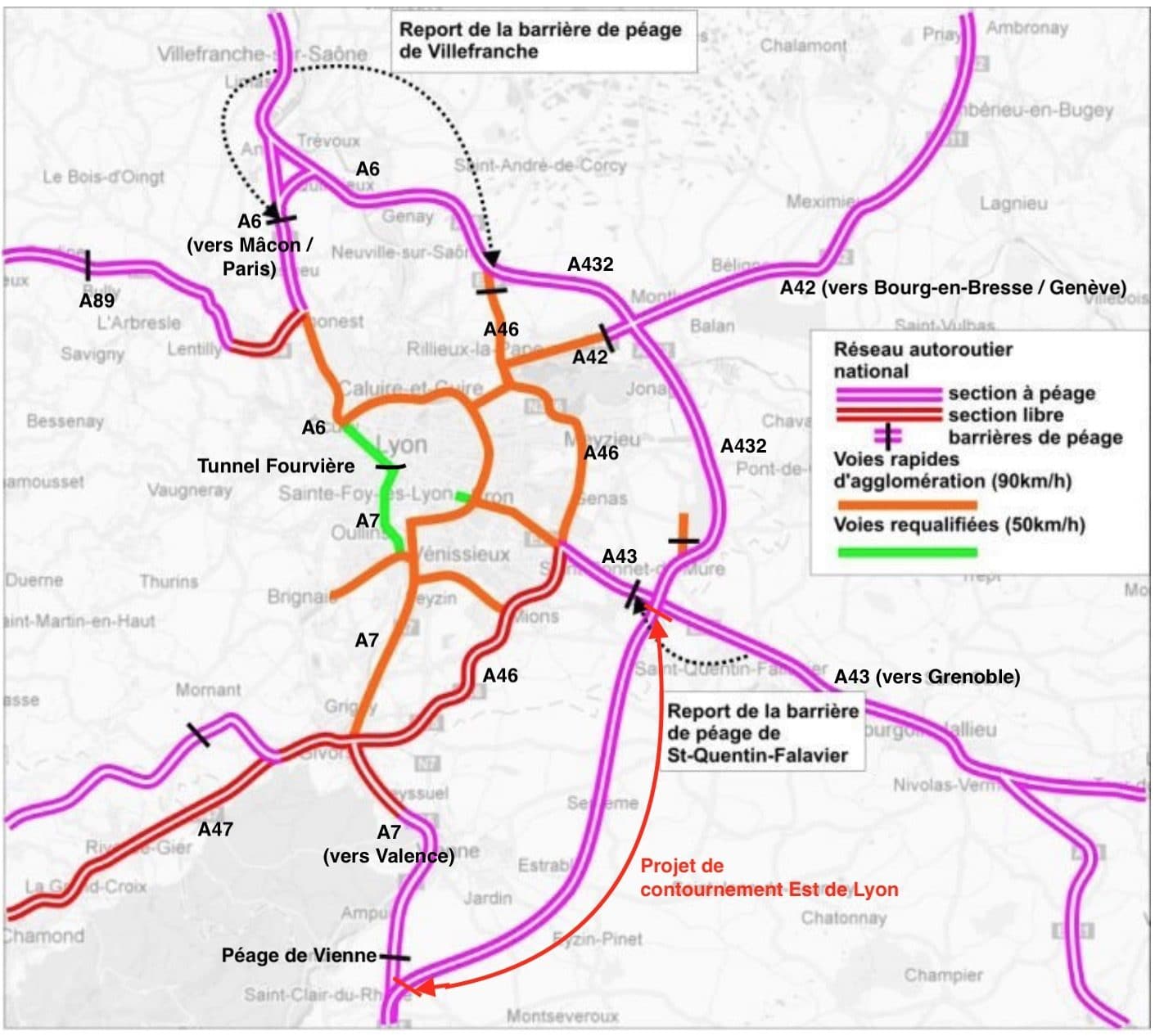Une fois de plus un lieu militant des Pentes de la Croix-Rousse a été pris pour cible. Cette fois-ci, ce sont deux syndicalistes, bénévoles pour une association écolo, qui ont été frappés alors qu’ils fermaient la librairie libertaire « La Plume Noire ». Une agression qui porte la marque de l’extrême droite radicale.
La scène s’est déroulée ce samedi 12 décembre, devant la librairie « La Plume Noire » située à proximité de la place Colbert, sur les Pentes de la Croix-Rousse.
Il était environ 19h30, quand deux bénévoles s’apprêtaient à fermer le local qui avait été utilisé toute l’après-midi pour une collecte de jouets et de vêtements pour Noël au profit de l’association PESE (Pour l’égalité sociale et l’écologie).
L’un d’eux témoigne à Rue89Lyon :
« Dix mecs nous ont entourés. Un seul a pris la parole pour nous demander si on ne connaissait pas un bar pour boire un verre. Les autres ne parlaient pas. C’était très bizarre. Il nous a ensuite demandé s’ils pouvaient boire un coup à l’intérieur de la Plume et ajoutant « vous étiez dix tout à l’heure. Ils sont où vos potes ? » C’est là que je me suis dit qu’on avait été observé et qu’on avait affaire à des types d’extrême droite ».
Les deux bénévoles ont pris des premiers impacts au visage puis se sont retrouvés à terre où ils se sont faits « rouer de coups » par « plusieurs personnes » pendant qu’un des membres de ce groupe « faisait le guet ».
« Je me suis dit que si personne ne les arrêtait, ils allaient nous tuer, par terre. J’ai quand même réussi à crier « au secours ». Il me semble.»
Des voisins sont arrivés et les ont fait fuir. Le groupe a dévalé les Pentes. Deux camionnettes de pompiers ont pris en charge les deux bénévoles, direction l’hôpital.
« Ils avaient la volonté de détruire »
Vu la violence de l’agression, les trentenaires s’en sortent plutôt bien. C’est surtout leurs visages qui ont été touchés. L’un a trois fractures dont deux au niveau des yeux et une au nez. Ses jours d’ITT n’ont pas été encore déterminés. L’autre avait également l’arcade sourcilière ouverte, le nez en sang, la lèvre coupée.
« J’ai aussi des hématomes au niveau des yeux, des côtes et au bras gauche qui m’a permis de me protéger le visage. Ils avaient la volonté de détruire.»
Pour l’une des deux victimes, tous les deux syndicalistes à Solidaires, le mode opératoire « accuse » les militants de l’extrême droite radicale.
« Ils ont observé le lieu avant d’intervenir. Un seul a parlé et a tapé le premier. C’était une opération commando de type militaire. »
Le lieu visé donne également une piste. La librairie libertaire a été plusieurs fois pris pour cible. La dernière fois, la plus violente, en novembre 2016. « La Plume Noire » avait été attaquée par des militants d’extrême droite munis de « pavés et barres de fer » aux cris de « La France aux français », quelques heures après un rassemblement de Catholiques traditionalistes, sur la place Colbert voisine.
Pour cette nouvelle attaque, les deux victimes ont déposé plainte dimanche auprès du commissariat du 1er arrondissement. Une enquête est en cours.

« Une nouvelle agression fasciste à la Croix-Rousse »
Dès le lendemain, un communiqué de presse commun Solidaires Rhône et l’Union Communiste Libertaire (UCL) – qui gère « La Plume Noire » – dénonçait « une nouvelle agression fasciste à la Croix-Rousse » :
« L’attaque est loin d’être anodine. Elle a été faite le jour d’une collecte de vêtements et de jouets organisée par une association en direction de familles démunies, en particulier les familles migrantes. Le lieu ciblé qui accueillait la collecte, a déjà subi par le passé des menaces, des collages sur sa devanture et une attaque en 2016 ».
Dans la suite du texte, les deux organisations rappellent la présence de locaux appartenant aux groupuscules d’extrême droite : une salle de boxe et un bar associatif gérés par Génération identitaire.
L’UCL et Solidaires réclament, une fois de plus, la fermeture de ces locaux.
« Combien d’attaques, combien d’agressions devront avoir lieu, combien de blessé-e-s devrons-nous dénombrer, pour qu’enfin des mesures soient prises contres ces groupuscules ? »
Selon Le Progrès, Génération identitaire rejette toute implication dans cette agression et parle de « diffamation ».
La question de la fermeture des locaux d’extrême droite
Dans un communiqué, le PCF, membre de l’actuelle majorité municipale, apporte son soutien aux victimes et appuie cette demande de fermeture de locaux. Pour rappel, la municipalité a récemment autorisé la réouverture du bar associatif des identitaires.
« Comment s’attendre à autre chose qu’à la succession d’attaques de ce genre quand l’extrême droite dispose à Lyon de locaux où préparer leurs ratonnades. (…) Nous demandons à nouveau à la mairie, au Préfet et au gouvernement de dissoudre Génération identitaire et de fermer les locaux lui appartenant ».
Ce faisant, les communistes se démarquent de leurs partenaires écologistes et de gauche.
Les groupes politiques Lyon en Commun (Insoumis-Gram), les Écologistes et La gauche sociale et écologiste (PS) se sont réunis « pour condamner avec force cet acte ». Mais dans leur communiqué commun, les trois groupes politiques regroupant les élus de la majorité au conseil municipal font preuve d’une plus grande prudence.
« Les premiers éléments semblent indiquer que ces actes ont été commis par des militants de l’extrême droite. Si ces présomptions sont confirmées par l’enquête, il s’agit d’actes très graves. Ce type d’acte n’a pas sa place dans notre société et nous souhaitons que les agresseurs puissent être identifiés et sanctionnés ».


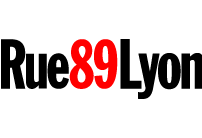






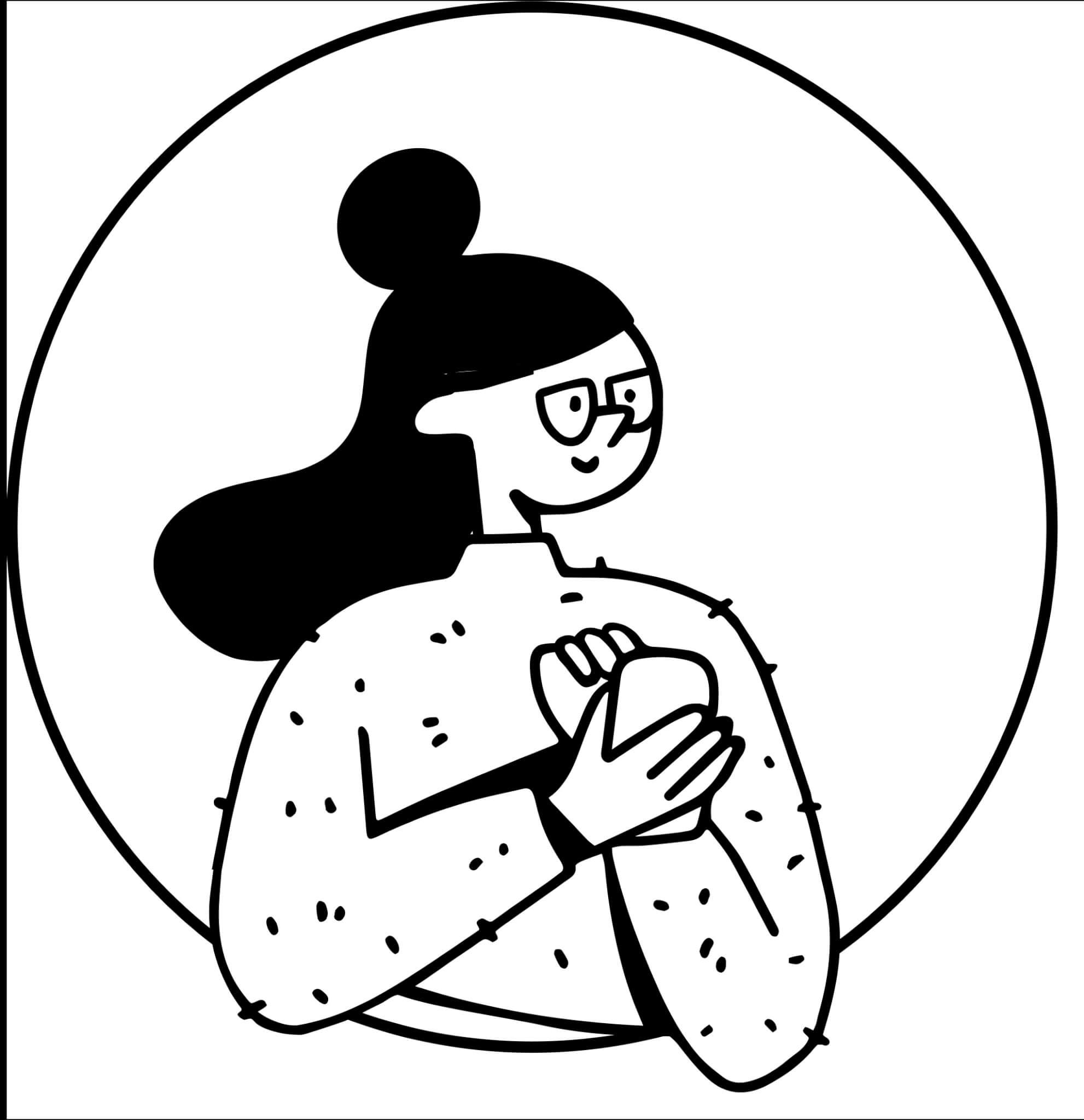



![[Podcast] Réflexions sur les enfants dans la ville post-Covid](https://www.rue89lyon.fr/wp-content/uploads/2020/12/IMG_0908.png)