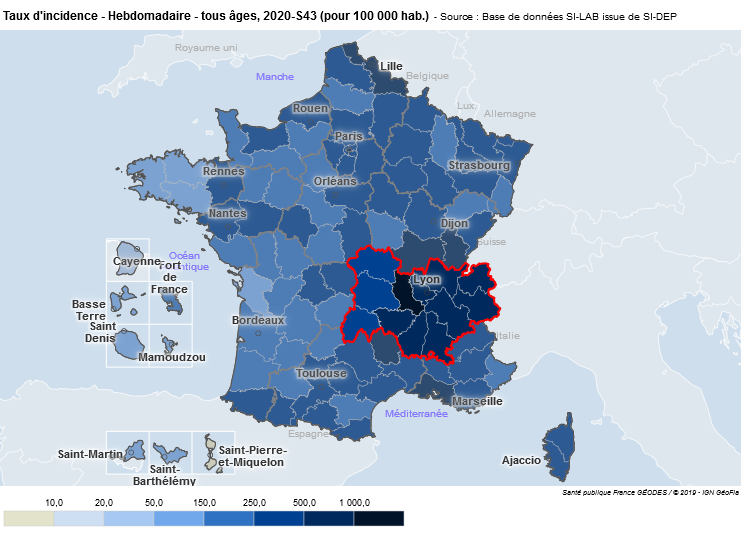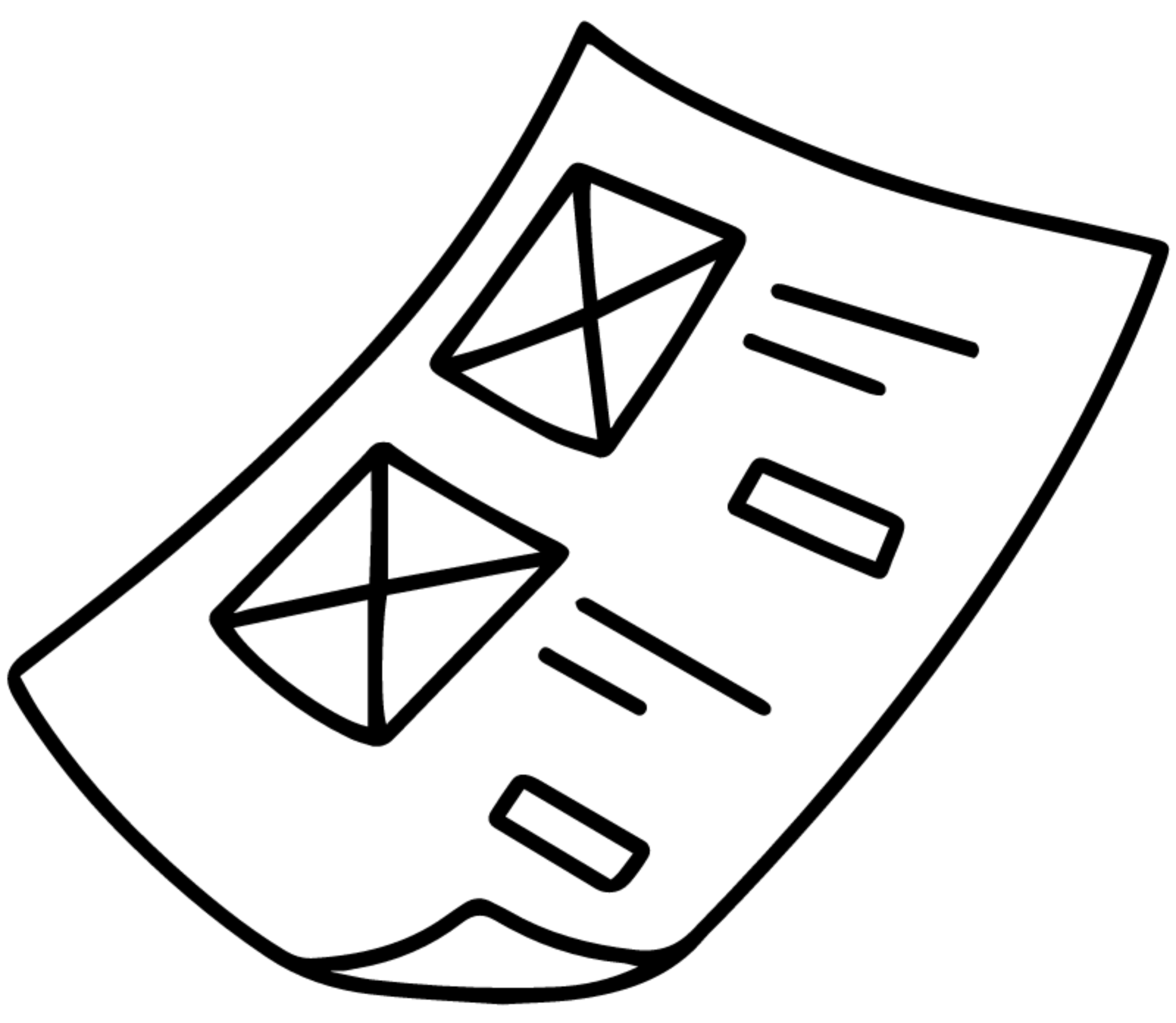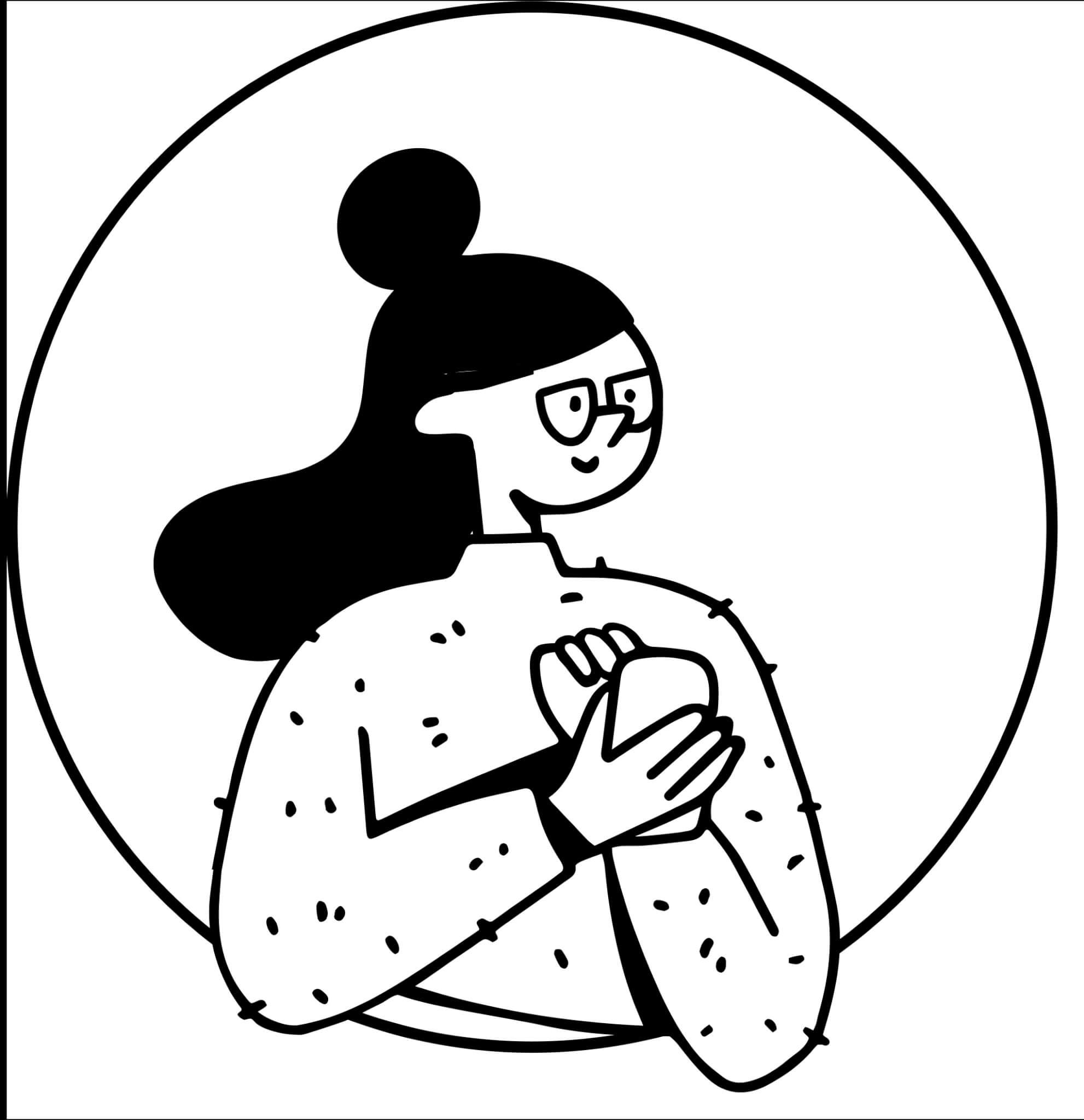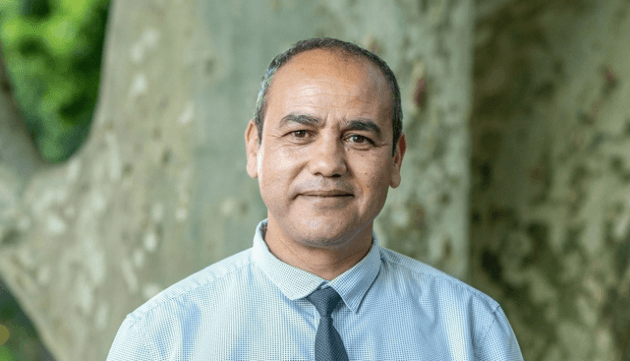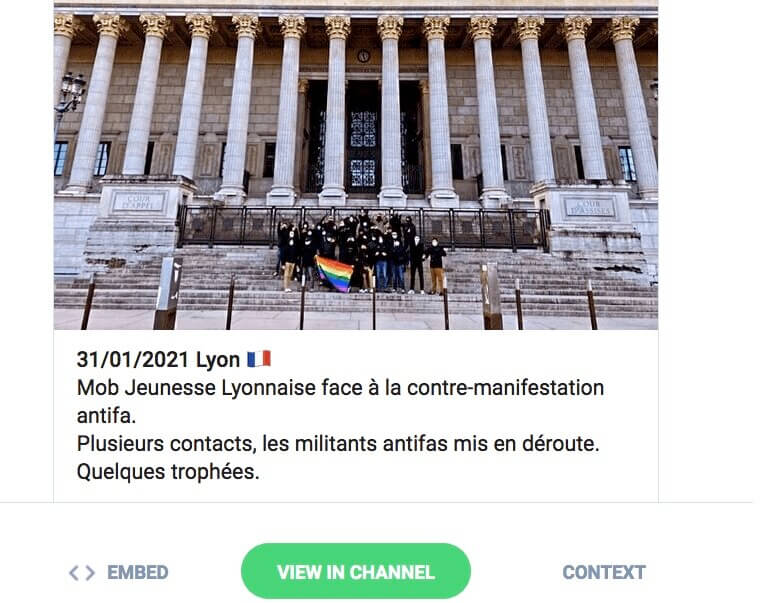À Lyon, depuis le début de la crise du Covid, les associations de l’urgence sociale constatent une forte augmentation des demandes d’aide et l’arrivée de nouveaux publics. Des personnes restées jusque là en dehors de leurs radars.
Au printemps 2020, lors du premier confinement, elles furent les rares vers lesquelles les plus précaires ont pu se tourner. Quand tout était fermé y compris des accueils de services sociaux, elles ont apporté « une aide vitale ».
Dans le cadre de notre enquête sur les conséquences sociales de la crise du Covid à Lyon et sa région, nous avons interrogé les responsables locaux de l’Armée du Salut, du Secours Populaire et de la fondation Abbé Pierre. Nous donnons reproduisons ici à leurs témoignages.
« Au début de la crise, les demandes d’aide témoignaient d’un besoin vital »
Le confinement de mars à mai a marqué tous les acteurs de l’action sociale que nous avons contactés. Les associations de l’urgence sociale ne font pas exception. Quand les rues étaient désertes et beaucoup de structures fermées, elles étaient les seules au contact des plus précaires.
Au Secours Populaire de Lyon, on indique que les stocks disponibles ont été « un filet de sécurité » et ont permis de répondre à la demande.
« Nous avons décidé de rester ouvert. On avait des stocks qui nous permettaient de répondre à la demande. Notamment grâce au programme annuel d’aide alimentaire. Ces 25 à 30 produits de base qu’on reçoit tout au long de l’année ont été un filet de sécurité. Quand tout était fermé on a reçu énormément d’appels de travailleurs sociaux qui nous demandaient de l’aide. On a aussi fait des livraisons pour celles qui avaient des problématiques d’approvisionnement. »
Sébastien Thollo, responsable du Secours Populaire de Lyon
Et les demandes ont afflué.
« On a eu une très forte demande au début de la crise qui était une demande d’aide alimentaire. Elle témoignait d’un besoin vital. A ce moment-là, l’aide en bons d’achat ne fonctionnait pas. »
Sébastien Thollo, responsable du Secours Populaire de Lyon
Au Secours Populaire de Lyon, les demandes d’aides alimentaires et d’urgence ont ainsi augmenté de 35% environ au début de la crise sanitaire.
Selon son responsable, elles ont depuis légèrement diminué. Sur le reste de l’année 2020, elles ont été toutefois en augmentation de 15 à 20% par rapport à l’année précédente.
« La demande d’aide est en progression depuis 2008 mais depuis le début du mois de mars 2020, c’est plus qu’une augmentation, c’est une explosion des demandes. Et au vu de l’ampleur, le Secours Populaire n’est qu’un acteur parmi d’autres «
Sébastien Thollo, responsable du Secours Populaire de Lyon
« Les demandes d’étudiants ont doublé dès mars dernier »
À l’Armée du Salut de Lyon, on témoigne également d’une hausse de la fréquentation durant la crise. Même si elle difficile à mesurer.
« Pendant le premier confinement on a dû fermer le restaurant social. On a pu le rouvrir depuis octobre, de façon inconditionnelle grâce à des aides de l’État. La fréquentation a augmenté mais impossible donc de faire une estimation précise de l’évolution de la fréquentation entre mars et la fin de l’année. Depuis octobre dernier, elle s’est stabilisée autour des 300 repas par jour. Quand le restaurant était fermé on faisait une distribution de repas devant la porte. On a pu servir jusqu’à 500 repas par jour. Beaucoup de personnes venaient parce que d’autres distributions étaient fermées »
Sophie Jansen, directrice de l’Armée du Salut Lyon
Aujourd’hui, la condition des étudiants est largement documenté. Il l’était moins au tout début de la crise sanitaire. Pourtant, certaines associations ont très tôt vu ce public venir vers elle plus massivement.
« Le nombre d’aide pour les étudiants a doublé dès le mois de mars dernier. Des étudiants ne pouvaient plus aller au restaurant du CROUS, certains avaient perdu leurs jobs. Fin mai début juin, une aide exceptionnelle de 200 euros leur a été attribuée. Mais elle le concernait pas les étudiants étrangers. Ils sont nombreux parmi ceux venus vers nous. Aujourd’hui encore les demandes de ce public sont deux fois plus importantes. »
Sébastien Thollo, responsable du Secours Populaire de Lyon
La Fondation Abbé Pierre, avance un chiffre :
« 20% des 18-24 ans ont eu recours à l’aide alimentaire. Les trois-quarts pour la première fois. »
« Trois fois plus d’aides d’urgence depuis septembre »
Durant ce premier confinement, les associations ont aidé les sans-abri mais aussi des locataires pour ne pas perdre leur logement.
« On a apporté à hauteur de 140 000 euros d’aides à la quittance de loyer dans le Rhône. A l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes cela représente 400 000 euros »
Véronique Gilet, directrice régionale de la Fondation Abbé Pierre
La Fondation Abbé Pierre répond à des besoins qui concerne l’ensemble de la question du logement : aides à l’équipement des familles, participation aux remboursements de dettes, paiements de factures d’énergie pour éviter des coupures, etc…
« Chaque année on délivre une centaine d’aides d’urgence, majoritairement dans le Rhône. Depuis septembre, on reçoit trois fois plus de demandes d’aide. »
Véronique Gilet, directrice régionale de la Fondation Abbé Pierre

« Ils étaient juste au-dessus de la surface de l’eau et ont plongé »
La permanence de la crise inquiète les associations. L’augmentation du chômage et une reprise tardive de l’activité économique deviennent encore plus problématiques quand « beaucoup de [leurs] publics arrivent en fin de droits au chômage ».
Les associations humanitaires mesurent également les conséquences de la crise sanitaire à la lumière des nouveaux publics qu’elles accueillent. Celles que nous avons pu contacter évoquent l’arrivée de personnes jusque-là pas concernées par l’aide d’urgence. Ou bien des personnes restées en dehors de leurs radars et pouvant bénéficier d’aides informelles. Pour elle, la crise sanitaire et les confinements ont pu les faire basculer.
« On a aidé environ plus de 7000 personnes. Certaines, on savait déjà qu’elles n’allaient pas très bien. Il y a une très forte exclusion des publics qui l’étaient déjà. Comme les gens du voyage par exemple. Ces publics ont été très malmenés. Mais d’autres étaient juste au-dessus de la surface de l’eau et ont plongé. Des personnes qui surnageaient et n’étaient pas dans l’extrême précarité. »
Véronique Gilet, directrice régionale de la Fondation Abbé Pierre
La crise a conduit vers les associations des personnes « peu protégées » par leur situation professionnelle.
« On a vu arriver des auto-entrepreneurs, des personnes assez peu protégées. Des personnes en intérim également. On a aussi eu beaucoup de demandes de la part de femmes seules avec des enfants. Du fait notamment de la fermeture des cantines scolaires lors du premier confinement. »
Sébastien Thollo, responsable du Secours Populaire de Lyon
« Beaucoup de gens sont sortis du bois pour demander de l’aide »
À la Fondation Abbé Pierre, on a vu appeler ou arriver des publics plutôt « invisibles » en temps normal.
« Un des indicateurs qui nous font pressentir que davantage de personnes sont touchées par la crise ce sont les appels provenant de personnes dormant dans leurs voitures. Ce sont des gens qui, par exemple, dorment sur le parking de leur entreprise qui a fermé. »
Un public plutôt difficile à toucher et à aider pour les associations, en temps normal. Dans cette crise, il s’est pourtant davantage tourné vers elles.
« La surprise a été que ces personnes appellent. Les personnes qui dorment dans leurs voitures sont difficiles à appréhender. C’est difficile pour nous à quantifier. Il existe beaucoup de tabous autour de ça. Un quart des sans-abri ont un travail. Les approcher et le montrer au grand jour peut être grave pour elles, elles sont elles-mêmes plutôt invisibles. Mais là beaucoup de gens sont sortis du bois »
Véronique Gilet, directrice régionale de la Fondation Abbé Pierre