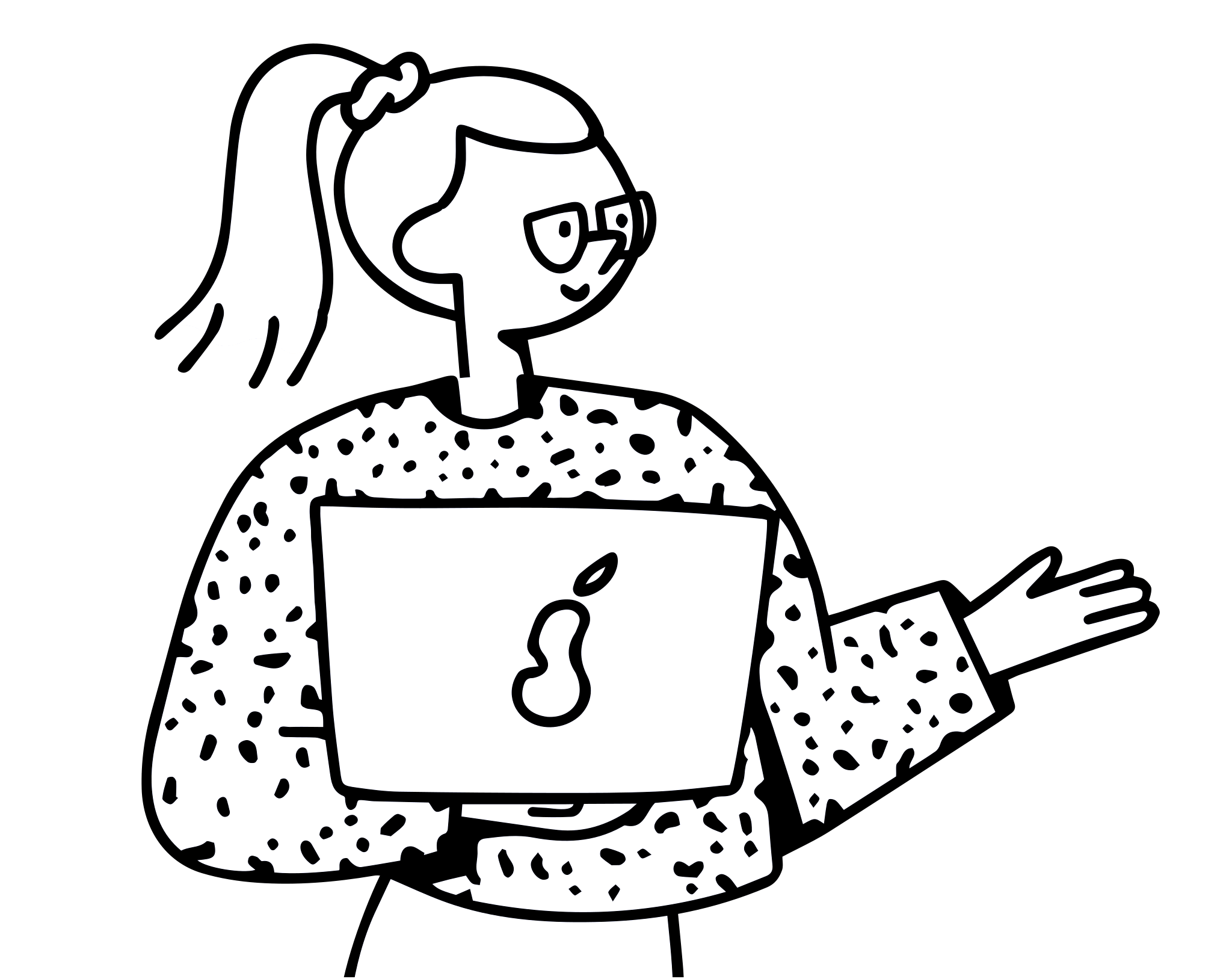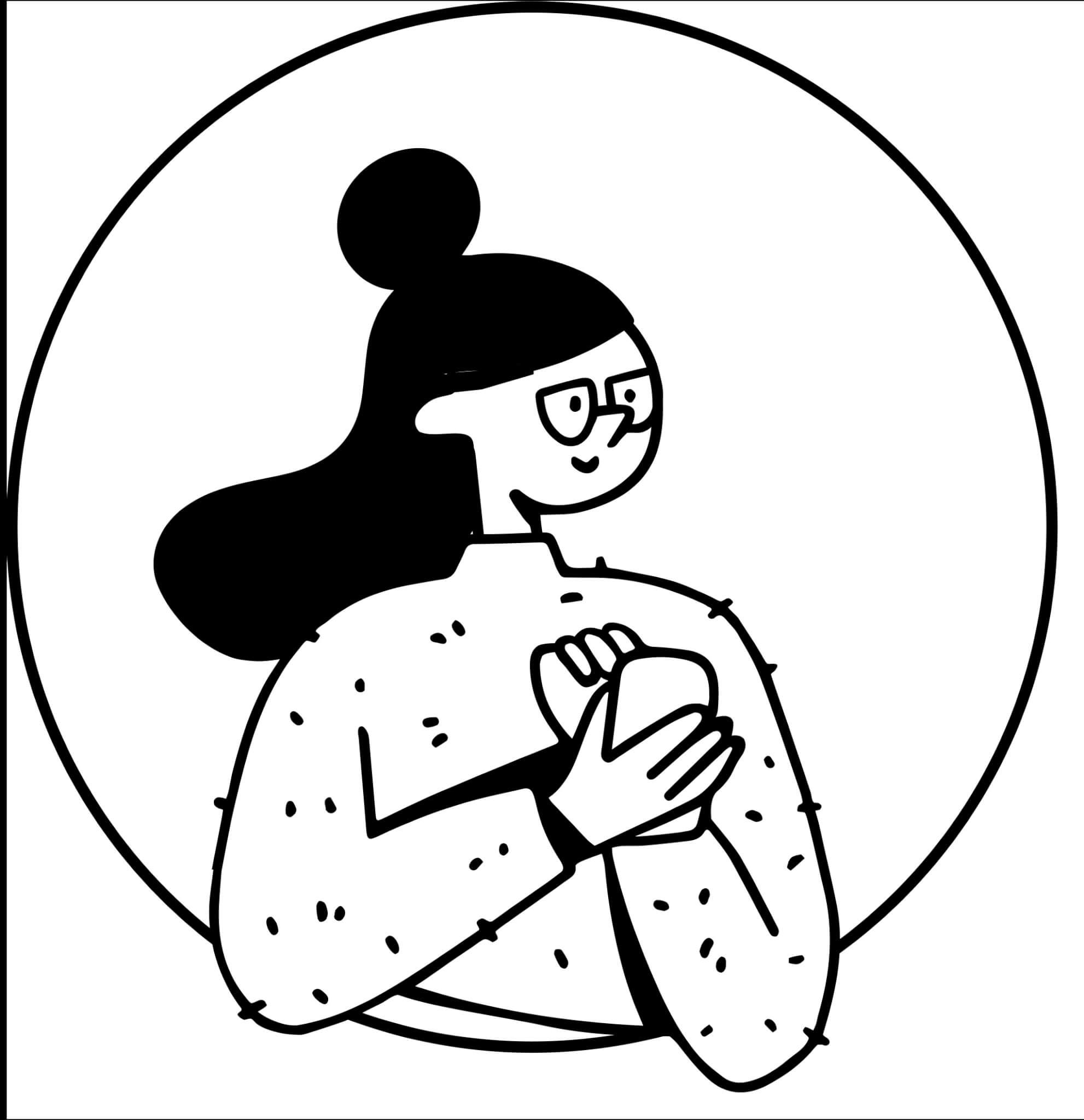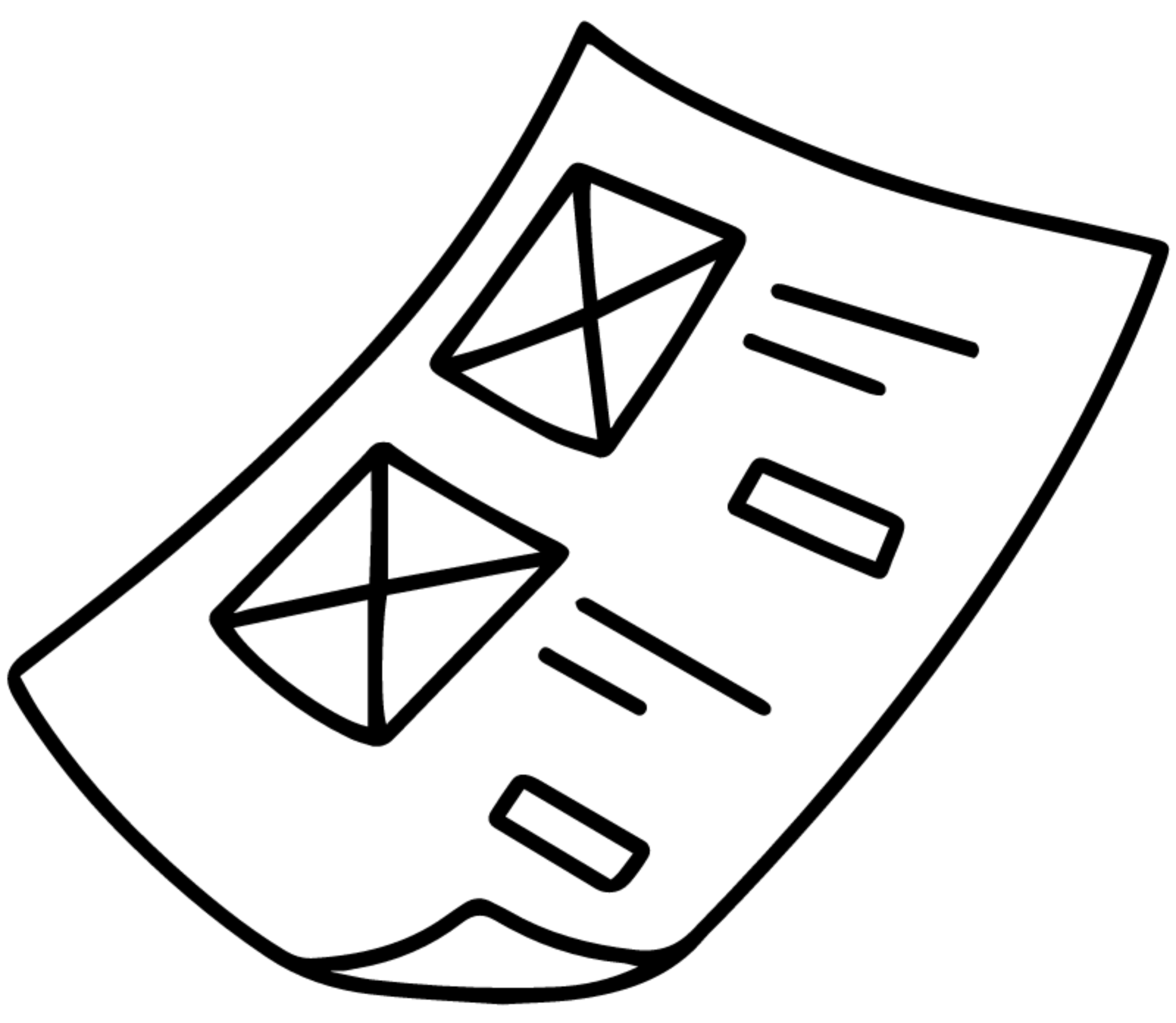Mardi 10 septembre, le tribunal administratif a du se prononcer sur un arrêté autorisant un projet d’extension de l’usine Arkema. Quelques mois plus tôt, c’était l’industriel Daikin qui était à la barre pour les mêmes raisons. Signe que la justice devient un lieu privilégié des luttes contre la pollution aux perfluorés. Compte-rendu et analyse.
« On parle ici d’une multinationale qui doit seulement investir pour une étude d’impact. Dans le pire des cas, on rassurera la population ! »
C’est une petite phrase de conclusion d’Antoine Clerc, avocat du cabinet Hélios, représentant la Ville d’Oullins-Pierre-Bénite. Une plaidoirie qui montre bien l’état d’esprit des collectivités et collectifs en vigilance contre les projets des géants de l’industrie Arkema et Daikin.
Ce mardi 10 septembre, la chambre 6 du tribunal administratif de Lyon accueillait une nouvelle audience concernant le dossier de la pollution aux « perfluorés ». Au programme : l’étude d’un « référé suspension » (dont le but est de suspendre un arrêté préfectoral) déposé par l’association Bien vivre à Pierre-Bénite, avec plusieurs membres du collectif PFAS contre Terre, la Ville d’Oullins-Pierre-Bénite et les associations Action justice climat (ex-Alternatiba) et Générations futures. Le tout contre un arrêté en date de 14 mai 2024.
Dans celui-ci, la préfecture autorise l’extension de l’usine Arkema via un projet répondant au doux nom de « Elynx » pour produire du « PVFD », un polyfluore utilisé pour les batteries de voiture. Elle considère que celle-ci :
« N’induit pas d’augmentation de la limite autorisée de fabrication de PVDF (polymère de fluorure de vinylidène), n’entraînera pas d’augmentation des rejets de substances per ou polyfluoroalkylées (PFAS) pour lesquelles une surveillance est prescrite à l’exploitant. »
Arrêté préfectoral du 14 mai 2024
Extension d’Arkema et Daikin/perfluorés : deux affaires en trois mois
En moins de trois mois, c’est la deuxième fois que le tribunal administratif hérite d’une attaque judiciaire contre un arrêté préfectoral autorisant une extension d’un groupe industriel. Hasard du calendrier (ou pas), cette audience a été précédée par une annonce de la préfecture concernant l’ouverture d’une consultation publique sur la création d’un nouvel atelier de Daikin.
En mars 2024, Rue89Lyon se penchait sur l’extension de cette activité, avec, encore et toujours, l’utilisation de substances perfluorées. Puis, des enquêtes, notamment de Médiacités et de France 3 Région, ont montré la dangerosité des activités du voisin d’Arkema.
Depuis, le tribunal administratif a donné raison aux opposants à cette extension. En ce début de semaine, Sébastien Bécue, avocat de l’association Bien Vivre à Pierre-Bénite, espérait bien faire appliquer le même « principe de prévention », avant même le principe de précaution, dans ce dossier aux nombreuses similitudes. Son but : que la société Arkema effectue une étude d’impact avant l’extension de sa production.
« En droit de l’environnement, la clef, c’est l’information. Si vous n’en avez pas, vous ne pouvez pas agir », note-t-il.
Or, de l’information, il en manque, selon les requérants, sur projet le « Elynx ». En gros : ils demandent l’intervention d’une autorité indépendante, hors préfecture, pour affirmer que tout roule dans le dossier de l’industriel. Ce qui serait possible avec une étude d’impact.

Pour Arkema : une extension pour aller « vers du mieux »
En face, l’avocate d’Arkema, et la préfecture, jouent la carte du « on a tout fait dans les règles. » Le dossier, « sérieux », selon les services de l’Etat, ne permettrait que « d’aller vers du mieux » avec un procédé moins polluant.
« Ce troisième réacteur va permettre d’arrêter d’utiliser un PFAS, actuellement interdit par arrêté », pose ainsi le représentant de la préfecture. « Ce troisième réacteur est prévu dans le cadre d’une procédure qui remonte à 2002 ! », marque également Élodie Simon, avocate d’Arkema. Au passage, elle rejoue la carte de « l’emploi avant tout ». Selon elle, l’usine de production de Pierre-Bénite est déficitaire depuis plusieurs années. Un retard de la production pourrait fragiliser l’activité économique de la plateforme.
En face, nécessairement, l’argument a du mal à passer venant d’une multinationale qui a tendance à fuir les lieux où elle commence à avoir trop d’ennuis… Les avocats mettent, notamment, en avant le cas d’une usine Solvay aux États-Unis. En mai, nos confrères de France 3 révélaient que l’industriel, produisant du PVDF, comme à Pierre-Bénite, avait été condamné pour pollution aux perfluorés. Cette unité de production avait été rachetée par le groupe Arkema, dans les années 1970. La situation ne risque-t-elle pas de se reproduire à Oullins-Pierre-Bénite ?
PFAS : Arkema et Daikin face à une confiance brisée
Cela n’empêche pas l’avocate d’Arkema de tenter de jouer la confiance. Les procédés sont différents, il n’y a rien à voir entre cette usine et celle de Pierre-Bénite… À voir les gestes réprobateurs des habitants de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite dans la salle, on comprend aisément que l’argumentation ne passe pas. Il faut dire que, depuis le début du scandale sanitaire en mai 2022, les preuves de la mauvaise foi de l’industriel s’accumulent. Forcément, cela le dessert.
« Ni les requérants, ni la commune d’Oullins-Pierre-Bénite ne souhaitent faire barrage à Arkema, lâche Antoine Clerc, avocat de la Ville. Notre but c’est d’éviter de nouveaux scandales. »
C’est bien là que se joue l’enjeu de ces procès. Si le tribunal donne raison aux associations, ce serait la deuxième fois, en moins d’un été, qu’il donne tort à la préfecture. Bien qu’il s’agisse ici de décision en « référé » (express, mais pas définitive), cela serait une deuxième défaite judiciaire pour les services de l’État. De quoi pousser à effectuer de nouveaux contrôles ? Ou à systématiser les études d’impact ? Nous n’en sommes pas encore là. Dans le cadre de l’arrêté concernant Daikin, l’État (tout comme Daikin) a fait appel de la décision du juge administratif. Concernant Arkema, la décision sera, elle, connue vendredi.