Petit Bulletin : Aviez-vous montré un film à votre équipe avant de tourner, comme vous le faites habituellement ?
Arnaud Desplechin : Je n’ai pas eu l’occasion, par manque de temps et parce que l’équipe était éclatée. Mais je sais que j’aurais montré Providence (1977) de Resnais, c’est sûr. Pour la furie de récits qui s’enchevêtrent et s’embouteillent dans la tête de John Gielgud, et le côté déchirant de cette femme qui se meurt d’un cancer. C’est un film avec lequel je suis arrivé à Paris, à l’époque il m’a marqué très fort. Je n’étais par truffaldien, mais resnaisien quand j’avais 17 ans et ça m’emplissait beaucoup.
Providence, c’est le choc de l’imaginaire contre le réel…
Oui, quelqu’un qui re-rêve sa vie, comme Ismaël dans la dernière partie du film, qui s’enferme dans son grenier pour refabriquer sa vie avec des bouts d’intrigues.
Sauf que votre film est davantage hanté par les cauchemars que les rêves…
Ismaël a en effet ce problème de cauchemars, le syndrome d’Elseneur Je l’ai découvert tardivement sur Arte — il n’y a que sur Arte que l’on peut voir des trucs comme ça ! C’est une vraie maladie tout à fait terrifiante, une forme d’épilepsie où vous faites toujours le même type de cauchemars avec des sauriens, des reptiles qui vous font vous réveiller en hurlant. Depuis dix ans que cette émission me trottait dans un coin de la tête, je me suis dit que c’était qu’Ismaël devait être hanté par des fantômes et des cauchemars, pas par des rêves. Les rêves sont moins délicieux.
Et vous, faites-vous des cauchemars ?
J’ai eu une crise de cauchemars très forte qui m’a duré plus de deux ans ; je suppliais pour que ça s’arrête. Je me réveillais toutes les nuits. Je serais incapable d’en donner la signification : c’était des cauchemars très prosaïques, qui reprenaient ma journée mais où tout se passait mal, très violents. Je pense que c’était parce que je venais de perdre quelqu’un auquel je tenais beaucoup. Par la suite, ma machine à rêves ne fonctionnait plus. Comme Ismaël, je peux dire — la réplique me fait rigoler parce qu’elle est snob — que j’ai relu la Traumdeutung il y a deux ans, La Science des rêves de Freud. C’est son plus gros livre, c’est le spécialiste de la question… Eh bien tout Freud qu’il soit, il n’a pas trouvé d’explication aux cauchemars !

Ismaël, qu’interprète votre alter ego Mathieu Amalric, est une sorte de double. Mais en quoi vous ressemble-t-il le plus ?
Aujourd’hui, avec Mathieu, je ne sais plus ce qui lui appartient, ni ce qui m’appartient ; ni qui a inventé ceci ou cela. C’est quelque chose que l’on a en partage, plutôt des masques, des déguisements. Quand je vois la quantité d’alcool qu’Ismaël, le réalisateur dans le film, absorbe… Pour moi, ce n’est pas possible avec le travail ; je n’ai pas sa santé, je suis plus frêle que cela. Et m’enfuir d’un tournage, ça ne fait pas partie de mon tempérament. En plus, j’ai peur des armes à feu (rires) J’ai l’impression que je me déguise pour vous amuser… et que je me trahis plus que je ne le sais.
Pourquoi reprenez-vous de film en film certains noms pour vos personnages ?
Ismaël Vuillard est apparu quand je travaillais avec un ami, Roger Bohbot, sur Rois et Reine. Je ne savais pas encore quel métier il ferait, mais je tenais à ce qu’il soit artiste — or pour moi au cinéma, les personnages d’artistes ont un privilège pas facile. Finalement, j’avais décidé qu’il serait altiste. Ici, comme je savais que je voulais faire un film sur un réalisateur, j’ai repris ce nom, parce qu’il n’est pas universitaire ni employé ou médecin. Quant à Dédalus, le héros de son film, c’est un personnage qui a le don des langues, un peu lunaire. Dans 3 souvenirs de ma jeunesse, il aimait beaucoup Dieu, mais aussi l’idée de faire un hold-up. On ne sait pas si c’est un espion, un imbécile, un naïf… On ne sait pas le classer. Les personnages inclassables, je les ai souvent appelés Ivan. Ça marchait bien.
Pour les personnages féminins, Carlotta est une référence très — peut-être trop — explicite à Vertigo (1958) d’Hitchcock…
J’ai déjà appelé un personnage Junon, alors… Sonia, Sylvia, Carlotta… Toutes les filles avaient un prénom en a, ça me semblait bien marcher. Mais le thème de ce film vient tellement de Vertigo ; c’est un mythe. Carlotta sort des eaux ; elle arrive de nulle part, de l’historie du cinéma — le cinéma sert à cela : à ressusciter les morts. Quand elle est habillée de son manteau blanc, je ne pouvais penser qu’à celui de Kim Novak dans Vertigo, même s’il est beaucoup plus modeste. Mais Marion Cotillard ne le joue jamais comme un mythe, mais comme une vraie femme — c’était très clair entre elle et moi. La capacité de Marion a être un mythe me fascine chez Marion — car très certainement elle l’est devenu depuis La Môme et cette carrière américaine qu’on lui connaît — comme sa capacité à se débarrasser de ses oripeaux du mythe ; à se réinventer chaque jour et à se dire “j’en ai rien à foutre“, à faire le film des frères Dardenne, Mal de Pierre, le Zemeckis ou autre chose. De passer d’un régime à l’autre. Le nom de Carlotta était mythique, mais j’ai fait confiance à la performance de Marion pour faire descendre la statue de son piédestal et la montrer telle qu’elle est.
Charlotte Gainsbourg aurait-elle pu être Carlotta ?
Bien sûr, même si les deux rôles sont opposés. Ça me fascinait de réunir ces deux artistes qui sont comme deux planètes, deux tempéraments de femmes différents, et de les voir dans le même cadre. Charlotte avait quelque chose qui m’était très précieux pour le rôle de Sylvia. C’est une artiste qui aime les extrêmes, on connait ses films avec Lars von Trier, et elle parle de Nymphomaniac avec beaucoup de joie et d’amusement, alors que ce sont des films qui font peur.
Je me souviens avoir été ébloui par Antichrist, la performance qu’elle avait faite m’avait stupéfait. Pour le rôle de Sylvia, cette fille qui s’empêche de vivre, il fallait un feu pour que le personnage fonctionne, et Charlotte a cette puissance-là. Ça me plaisait de la voir dans ce rôle un peu woodyallenien. J’ai l’impression de voir les trois femmes de Hannah et ses sœurs en même temps, surtout le personnage de Barbara Hershey, qui me touche beaucoup.
En outre, Carlotta s’adresse à plusieurs reprises au spectateur…
Elle raconte l’origine de la rencontre avec Ismaël et elle fait l’épilogue. Ça me plaisait qu’elle devienne la narratrice du film, que ce ne soit pas un privilège masculin et que le récit soit offert par une femme. Et ça me semblait logique qu’elle termine. L’épilogue pourtant est venu au dernier moment de l’écriture. J’aurais pu m’arrêter avant, mais je savais que le film n’était pas terminé, je travaillais encore sur le scénario, je ne l’avais pas donné au producteur, quand j’ai mis ce point-là. Trois souvenirs… était un éloge de la nostalgie, avec ce personnage tout raidi, très seul, renfermé sur lui-même pour préserver le passé. Ici, tous les personnages laissent le passé derrière, il faut qu’ils avancent. Carlotta dit à la fin — la façon dont Charlotte le dit m’émeut au larmes — :
« La vie m’est arrivée. Imparfaite, gauche pas comme je l’attendais, mais ça m’est arrivé. »
J’ai l’impression que c’est ce que chaque personnage pourrait dire. J’avais besoin d’arriver à cette phrase là, qu’elle arrive à condenser tout le film dans ce monologue de fin.
Il est clairement dit qu’elle sauve Ismaël…
C’était le thème. C’est très américain, de s’offrir une deuxième chance. De se réinventer. Si vous avez une rupture amoureuse, ça vous prend dix ans. Sauf que là, ils n’ont pas vingt, ni trente ans, ils ont dépassé quarante ans. Si là ils merdent, c’est grave. Calculez : oh la la, dix ans de plus, ça va être difficile à négocier ! Ils se donnent une dernière chance d’être en vie, de se sauver l’un l’autre. Elle, en étant trop raisonnable, elle s’empêche la vie ; lui en étant sûrement trop désordonné, il s’empêche la vie aussi. Tout les oppose, ils sont obligés de s’acclimater. Ça me passionnait de regarder ce couple si mal assorti bricoler quelque chose ensemble.
Le film tend vers l’apaisement. Paradoxalement, la création favorise l’apaisement mais fait revenir des fantômes…
Le film est apaisé, mais Ismaël ne s’apaise pas du tout : le fait d’être apaisé le plonge dans le désarroi, il s’enfuit. Peut-être que ça tient aussi à ma différence de perception entre les personnages masculins et féminins. Mes personnages masculins, j’aime bien leur conférer un certain ridicule, qu’ils soient ballotés par les événements. C’est pour ça qu’Ismaël ferait un très mauvais narrateur à la fin : il est comme une balle dans un flipper, il rebondit sur les trucs, il est totalement perdu… Ça me plaisait d’intervertir : dans le cinéma classique des années trente ou cinquante, c’étaient les personnages masculins qui négociaient avec leur destin, et les femmes faisaient décoration. Là, ce sont les femmes qui ont des destinées et les hommes sont bousculés par les événements.
Qu’est-ce qui est si fascinant dans le protestantisme de Sylvia ?
(sourire gourmand) C’est sexy ! Vous vous souvenez de la réplique d’Hitchcock, à propos d’une blonde dans le taxi à côté de vous et qui se précipite sur votre braguette ? Je sais qu’Ismaël est catholique, qu’il n’est pas juif et très lié à Bloom et à Zwy, donc quand il voit une protestante, il trouve ça très sexy. Ça le fait rêver puisque ce n’est pas sa propre religion ; évidemment ça l’attire.
Lorsqu’Ismaël est au plus fort de sa crise, il part dans un délire qui unit perspective picturale et religion…
Il y avait un double truc qui me plaisait. C’est compliqué pour moi de filmer des personnages d’artistes parce que je me méfie d’eux. Là, je m’en suis sorti parce que je trouve Ismaël assez modeste : il se dit fabricant de films. Il m’importait qu’à un moment, il prenne son travail très au sérieux. Mais plus sur son film, sur le cinéma en général ou les systèmes de perspectives.
Devant son ami Zwy, il dit qu’il va régler le problème de l’antisémitisme européen en résolvant le la question de la perspective des Époux Arnolfini avec Fra Angelico ! (sourire) Ça me rappelle des articles de Jean-Louis Comolli dans les années soixante sur la caméra qui répliquait le capitalisme parce que la perspective était un outil bourgeois !
« Si je règle la perspective, j’arrive à abolir la haine. »
c’est évidemment trop demander au cinéma — c’est ce que son ami lui dit. Il y a le fait de prendre la théorie très au sérieux, et un côté cocasse à le voir devenir fou.
Est-ce un film théorique ?
Pas théorique, mais de déclaration d’amour au cinéma, très certainement. Avec l’idée de compresser des images, de prendre des fragments de fiction et de les compresser les uns contre les autres. De compresser ces histoires et de rajouter des temps de récit. De se perdre dans les méandres — de vous perdre et de ne pas vous perdre, également. Au début, je peux le dire, c’est une citation de Broadway Danny Rose — quand il a disparu et que tous ses amis sont réunis dans un diner pour parler de lui. Ici, c’est dans une brasserie que des diplomates racontent des fragments d’histoires et les aventures de Dédalus. Le film commence sur une débauche de fiction, puis on arrive brusquement sur Ismaël tout seul en train d’écrire ; puis Bloom l’appelle, et nous voilà plongés dans la vraie vie. Il y avait une envie de dépense de fiction.
La structure narrative est terriblement complexe. A-t-elle été difficile à mettre en place ?
Elle a demandé beaucoup de discipline. J’ai travaillé avec deux amies scénaristes : par Skype avec Julie Peyr, avec qui j’ai écrit le film précédent, et comme ce n’était pas assez j’ai rencontré Léa Mysius, qui a un film à la Semaine de la Critique. Quand j’écris, je fais tout un travail d’improvisation, de burlesque — je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais. Julie consigne et me renvoie mes impros, puis et on les retravaille. Avec Léa, il y eu tout un travail de rationalisation : j’avais l’impression chaque matin de vous perdre avec délices dans les plaisirs de la fiction et de vous tenir par la main — c’était exactement la même chose — pour que vous puissiez vous repérer. Ça demande tout un travail sur la structure, qui est repris au montage, pour que vous soyez perdus et pas perdus, et puissiez éprouver les deux plaisirs en même temps.
En avez-vous autant bavé au montage que sur les films précédents ?
Plus. Parce que la structure de récit n’est vraiment pas facile à mettre en place, le montage était plus ardu. Il ne faut pas se perdre avec ces sautes de régime et de récit. Ce que l’on film est différent des choses qui marchent à l’écrit ; ce que l’on monte est encore différent… Du coup c’était un travail assez fin. Il y a cette phrase de Truffaut :
« Il faut filmer contre ce qu’on a écrit et monter contre ce que l’on a filmé. »
J’essaie sur le tournage d’attraper de la vérité, mais je ne sais pas la théoriser. Je suis dans un rapport très charnel aux acteurs : je sais à peu près les guider intuitivement, mais après c’est un travail de rationalisation au montage.
Où avez-vous tourné ?
À Noirmoutier — on voit le passage du Goix, que je tenais à filmer. J’avais besoin d’une île pour enfermer mes personnages.
Ça renforce l’aspect bergmanien du film…
Bien sûr. Persona, La Honte… Tous les films qu’il a tourné dans l’île de Fårö. Et c’est vrai qu’il y avait ce huis clos.
Votre travail au théâtre a-t-il eu une influence sur votre écriture ?
J’ai l’impression d’avoir toujours fait des films assez écrits. Sur le précédent, j’avais cette angoisse : les jeunes acteurs allaient-ils avoir l’usage des mots que j’invente ? Mais ils en ont eu l’usage et j’en ai eu une grande fierté. Je crois que cette expérience du théâtre — Père de Strindberg à la Comédie-Française — m’a influencé dans mon rapport aux acteurs. J’arrive à leur donner quelque chose que je savais moins bien leur donner auparavant. J’étais trop nerveux avant, trop empêtré dans mes angoisses pour leur rendre la joie qu’ils me donnent.
Quand je me suis retrouvé devant ces acteurs de théâtre, qui en savaient tellement plus que moi, j’étais très impressionné. Il y avait une espèce de confiance à les laisser inventer, à parier chaque matin lors des répétitions. Et quand ils trouvent, il faut leur rendre.
Du coup, j’ai réussi à avoir un rapport heureux aux acteurs, encore plus épanoui et solaire ; à ne pas les embêter avec mes cauchemars. J’arrivais à les accueillir, j’ai été disponible par le théâtre. Je me souviens l’avoir dit à Marion le dernier jour de tournage. Enfin… je lui ai envoyé un texto. C’est ridicule, parce qu’on était à trois mètres l’un de l’autre (rires).
Critique des « Fantômes d’Ismaël »
Arnaud Desplechin entraîne ses personnages dans un enchâssement de récits, les menant de l’ombre à la lumière, de l’égoïsme à la générosité dans un thriller romanesque scandé de burlesque, entre John Le Carré, Bergman, Allen et Hitchcock. Vertigineusement délicieux.
Revoici Desplechin en sa pépinière cannoise, là où il a éclos et grandi. Qu’il figure en compétition ou pas importe peu, désormais : les jurys l’ont, avec une constance confinant au gag, toujours ignoré. De par sa distribution glamour internationale, Les Fantômes d’Ismaël convient à merveille pour assouvir l’avidité multimédiatique d’une ouverture de festival. Il allie en sus les vertus quintessentielles d’un film d’auteur — d’un grand auteur et d’un grand film.
Ismaël en est le héros paradoxal : inventeur d’histoires, ce cinéaste se trouve incapable de tourner après que Carlotta, son épouse disparue depuis vingt ans, a refait surface dans sa vie. Plus fort que ses fictions, ce soudain coup de théâtre a en outre provoqué le départ de sa compagne Sylvia…

Du grand spectacle
Si Desplechin exprime ici un désir frénétique de romanesque, il montre que l’imprévisibilité de l’existence surpasse par son imagination la plus féconde des machines à créer… dans le temps qu’il démultiplie les déploiements d’arcs narratifs internes ou croisés, comme les niveaux d’inclusion du récit (passé/présent ; fiction/réalité ; songe/éveil). Prétérition que cette manière de minimiser la puissance du conte en révélant son incommensurable pouvoir ! Cela n’est pas sans évoquer la vraie-fausse procrastination du narrateur de Trois jours chez ma mère de François Weyergans— un portrait d’auteur indécis débouchant sur un roman brillant d’épure et un Goncourt. Quand l’inaboutissement apparent devient un parachèvement…
Desplechin n’aimant rien tant que tendre des fils virtuels entre ses films, chaque nouvelle œuvre en resserre davantage les liens. Pivots de son cosmos, ses personnages feignent d’être récurrents : une même identité peut ainsi se trouver incarnée par des individus dissemblables et cependant proches, avatars successifs d’une “idée”.
Et ces personnages se confondent avec les acteurs : aux côtés de l’inamovible Amalric, Marion Cotillard resurgit ici dans la galaxie Desplechin après avoir été la figure évanescente et muette de la Pentecôte dans Comment je me suis disputé … il y a vingt ans. Lestée à présent d’une gravité (à toutes les acceptions du terme) seyant aux mystères de la spectrale Carlotta. Non pour hanter ni châtier mais, les tourments passés, annoncer en définitive une épiphanie, une joie. Desplechin, cet optimiste caché…
Au cinéma à partir du 17 mai







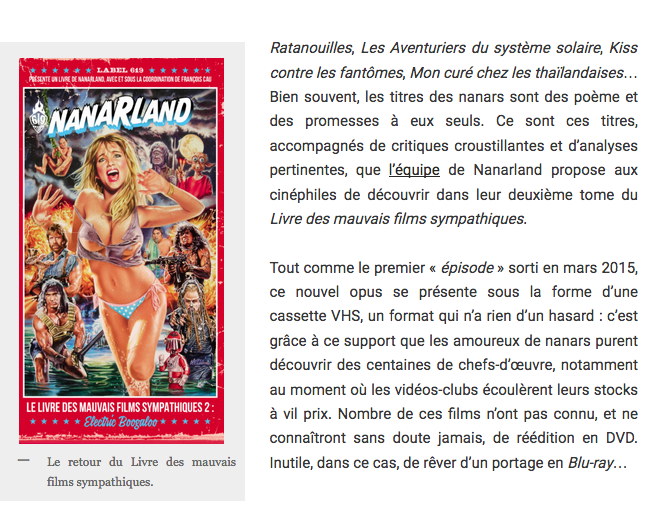


Chargement des commentaires…